Sous cette peau glabre qu'ils voilent de fringues, qu'ils masquent sous huiles et fragrances, qu'ils relèvent de crèmes, d'épices, sous cette extension de masque, le squelette pathétique d'une machine erronée. Ils portent la mort en eux. Une calavère se cache sous leurs traits délicats, les orbites blanches à peine colmatées de leurs beaux yeux ternes à reflet de faïence, le crâne d'os élimé - et les cheveux quittent le navire. Leurs organes se ressemblent et les fluides qui les traversent s'assécheront bien assez tôt, à l'aune du dernier souffle.
Il faut pourtant les voir, au moins une fois dans cette vie, cette morne et longue vie, se pavaner sur leurs allumettes de viande rance, leurs os cassants, bientôt poussière et sable noir. Il faut les voir braver la grande cagoule, celle qui trépigne et attend, les ongles corrodés. Elle sait pourtant, la gueuse, qu'elle gagnera la partie, qu'elle emportera la mise. Aucun atout qui vaille, aucun as glissé dans la manche, le jeu est truqué lorsqu'elle lance les dés. Et elle trépigne encore, elle ronge son frein, parce que la mise est chère et qu'elle déteste perdre - et elle ne perd jamais ! Elle est rêve et silence, pureté, promesse d'ailleurs, propose ses charmes indifféremment en n'offrant toutefois d'elle-même qu'une étreinte glacée, un trajet sur le Styx, une pâle biographie.
On la frôle, on l'aguiche, on la fuit, on la hait, mais qui sommes-nous pour espérer l'entraver ? On lui jette constamment des colifichets. On se signe dans son dos, on crache et on blêmit. Elle se fout royalement de toutes nos simagrées, royale dans son maintien, humble dans son avancée.
Soignez vos mines réjouies, vos faces rondes, vos gueules cassées. Activez vos sourires, renouvelez le fard sur vos pommettes en toc, gommez vos rides à coups de fond de teint, transformez-vous presto en tequila sunrise, en cruelle pantomime du moi qui vous poursuit, redessinez les trognes de vos âmes déconfites. Le corps est une geôle et la pensée son geôlier.
La peau se fane, se racornit, se craquelle, la chair se fendille et la viande s'avarie. Les os se brisent, le sang noircit, le monde est peuplé de cadavres dont les cellules dysfonctionnent par automatisme. Je veux vivre et m'affranchir du cloaque, viser la force brute d'un soleil de pacotille, jouir du bras de fer avec une lueur d'étoile, ensevelir ma cendre sous une lave ardente pour renaître en phénix dans un branle-bas de plumes. Je suis or et diamant, cuivre et charbon. Je suis gaz et torrent, avalanche et chaos. Mes nerfs dictent un poème à la vague, à l'écume, aux embruns, au ras-de-marée. Je suis un être immonde mais ma pensée soulève des monts et des collines, des châteaux, des armées. Elle fomente des complots et les plus noires révolutions contre l'usure et l'érosion, la vieillesse et le temps qui nous suçote et nous ronge. Elle s'insurge, vaine et conne, à l'assaut des chutes libres, des fouines et des dévots, réduit le sexe en cendres lorsqu'il n'est qu'animal, instinct et boucle vide.
Je suis un pan de mur dont les briques mal taillées s'embrassent et s'enchevêtrent sans jamais s'enrouer - mais je ne soutiens nulle masure, cabane ou bungalow.
Allez vous faire foutre, sans me prendre au pied de la lettre, toutefois. Ne flattez plus vos corps sous mon nez délicat. Entortillez-vous les guiboles le plus loin possible de moi, jouissez dans vos calebasses, baisouillez dans l'isoloir, ravalez votre foutre, épongez votre cyprine, effacez donc l'ardoise de mes espoirs déçus, le schéma délétère de mes pauvres illusions. Je ne veux plus de vous, je ne veux plus rien attendre, la vie m'ennuie, m'ampute et m'indiffère, et mon cesna décolle d'ici quelques minutes, en partance pour nulle part - le copilote est ivre et le commandant de bord a bouffé un space cake.
Assied-toi.
Merde et remerde.
Assied-toi et réfléchis.
LA ZONE -
![[illustration]](/data/img/images/2016_02_14_jetdebile02_big.jpg) Allez vous faire foutre, vos corps me font gerber. Ils coulent sur ma rétine comme le foutre brûlant d'un plus riche que les autres sur les doigts prophylactiques du gamin berlinois. Ils glissent, tendrement distordus, dans le décor crû et factice de leurs orgies souterraines. Leurs mouvements chaloupés empruntent aux mécaniques la marche du rouage et l'affect du saltimbanque. A chaque épaule s'accroche un fil dérisoire, à chaque rotule et aux deux coudes, aux jointures de chaque doigt. Ils ignorent l'identité de celui qui les meut, les assoit, les allonge, mais nulle résistance, nul questionnement - ils subissent et n'y trouvent rien à redire.
Allez vous faire foutre, vos corps me font gerber. Ils coulent sur ma rétine comme le foutre brûlant d'un plus riche que les autres sur les doigts prophylactiques du gamin berlinois. Ils glissent, tendrement distordus, dans le décor crû et factice de leurs orgies souterraines. Leurs mouvements chaloupés empruntent aux mécaniques la marche du rouage et l'affect du saltimbanque. A chaque épaule s'accroche un fil dérisoire, à chaque rotule et aux deux coudes, aux jointures de chaque doigt. Ils ignorent l'identité de celui qui les meut, les assoit, les allonge, mais nulle résistance, nul questionnement - ils subissent et n'y trouvent rien à redire. = ajouter un commentaire =
Les commentaires sont réservés aux utilisateurs connectés.

![[nihil.fr]](/assets/img/nihilique/btn-rouage.jpg)
![[imprimer]](/images/print.png)




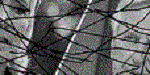

= commentaires =
Et le voilà enfin. L'homme qui pourra expliquer à la face du monde ce que peuvent bien être des doigts prophylactiques.
C'est un texte parfaitement honnête en plus, on n'ira pas jusqu'à dire ciselé parce qu'on n'est pas dans la salle de rédaction du Monde et que ce n'est pas le cas, mais en tout cas c'est imagé, croustillant et senti.
Sans révélation bien sûr, mais qui a des révélations à faire aujourd'hui ? A part Jean-François Copé, personne.
Autant de -bonnes- raisons d'évincer cette seconde phrase abstruse et vainement provocatrice, tel un migrant égaré en centre-ville. Et de mettre un z à raz-de-marée ainsi qu'un s à assieds-toi.
C'est périlleux, imaginez qu'un lecteur exigeant et d'humeur particulièrement ravageuse tombe d'emblée sur des doigts prophylactiques comme ça, eh bien il fermera son navigateur et ira voir Holiday on Ice.
Je n'aime pas le patinage, ça m'emmerde.
J'attends de lire du Mill maintenant, j'avais apprécié le dernier en date.
Ca ne sert à rien de tourner autour du pot, il y en a 5, faudra bien les lire un jour.
Allez.
Je vais déroger (rabbit) à la règle et poster le texte d'un autre admin si ça te démange autant. Je suis incapable de laisser quelqu'un dans la souffrance.
sur un crétin mondialisé lors d'une escapade sur Omegle.
J'avais nonchalamment aiguillé la conversation sur l'oeuvre de Salinger et de Copé, quand ce mouflon universitaire s'est mis en tête de me sermonner sur la nécessité absolue -au risque d'affronter "la honte à la fac"- de lire tout oeuvre littéraire dans sa version originale.
Vous demandez-vous.
Eh bien après un bref échange inter-générationnel que j'ai émaillé de réflexions visant à l'apaisement, il était patent que l'homoncule transatlantique n'avait aucunement l'intention de lâcher le morceau.
Sur quoi, j'ai négligemment qualifié son fanatisme d'ubuesque et mon appétit francophile de gargantuesque, deux termes, vous l'aviez compris, intraduisibles.
Et quand on sait que la traductrice en français des romans de Barbara Cartland n'est autre que la mère de Frédéric Beigbeder, pourquoi effectivement se priver de la valeur ajoutée d'un exégète post babylonien.
de souligner l'indécente ingratitude des lecteurs -et parfois même des auteurs- pour ce corps de métier.
A mon sens, au lieu d'une rémunération forfaitaire, le traducteur devrait bénéficier d'un pourcentage.