Thé ou café, c’est toujours la question. Le thé pour l’ambiance chaude et calme qu’il produit en moi, le café pour la débauche d’énergie qu’il développe dans mes artères et sous mon crâne. Ce soir, du thé.
Antoine est devenu mon ami imaginaire.
Antoine est l’homme, jeune ou moins jeune, qui accompagne chacune de mes pages, mais je suis le seul à connaître sa réalité. Mes amis, ma famille, ma femme et mes enfants ignorent jusqu’à son nom et je me fais reprendre lorsque j’évoque une de ses frasques ou l’un de ses bons mots face à eux.
Antoine n’existe pas.
Antoine est un jeune garçon plein de vie ; Antoine est aussi bien blond que brun ; Antoine est un étudiant idéaliste ; Antoine est un poète maudit ; Antoine est un spationaute sur le point de mettre à feu son engin ; Antoine est un guerrier antique ; Antoine est un ouvrier à la chaîne, il travaille de nuit ; Antoine a autour de son cou un collier de bois et aux doigts de la main droite trois bagues d’argent, il est bassiste ; Antoine attaque des trains de marchandises dans les années vingt, il porte le collier de barbe comme les jeunes bourgeois, une montre gousset et un traité sur la mécanique dans sa poche droite, mais il tire comme un prince et frappe plus fort que tous ses hommes.
Antoine est grand, Antoine est fort, Antoine est une merveille. Moi…
Chaque soir je m’arrête, je dépose ma vie et ses routines, pour retrouver Antoine. Thé, ou café. Plume, et fumée. Et le tourbillon de l’alcool, plus tard, lorsque la théière est vide, le café froid et incrusté au fond de la tasse, et que la marée monte.
Parfois, je dois attendre Antoine. Antoine est un jeune homme capricieux. Antoine a ses occupations. Antoine braque des banques en Afrique du Sud, Antoine conduit des camions remplis d’or en Amazonie, Antoine reçoit beaucoup, la nuit, dans sa villa de Milan. Antoine n’a pas que ça à faire. Ce soir, je l’ai attendu un long moment, face à ma feuille. Puis face à mon écran. Puis à nouveau face à ma feuille, en griffonnant des traits de visage, le visage d’Antoine. Il n’est pas venu. J’ai bu mon thé en vain. Après mon thé, j’ai ouvert une bouteille. Antoine aime les grands crus. Je lui offre un Côte de Nuits, ce soir. J’en suis au troisième verre.
Et voilà qu’il apparaît, alors que je ne l’espérais presque plus, de l’autre côté du miroir de l’écran éteint, et qu’il m’ouvre les portes de la profonde forêt de l’imagination.
* * *
Ma femme entre dans mon bureau, un paquet de linge sale sur les bras.
- Jean, tu avais promis de m’aider à changer et à coucher la petite, pendant le repas, tu peux venir, là ?
- Je… Antoine vient d’arriver et…
- Que… Qui ? Bon Jean tu viens j’ai du tr-
- TU SORS !
J’ai crié sans prévenir, parce que je ne savais pas que j’allais crier. Je me suis retourné vers elle, les yeux exorbités, et j’ai hurlé comme on claque une porte qui laisse entrer des courants d’air. Le visage de ma femme s’assombrit d’un coup, le paquet qu’elle tient tombe au sol.
- Je déteste quand tu cries, Jean. Tu me fais peur.
- Allez, quoi… Excuse-moi, mais tu sais, je… je viens de commencer, et…
- Tu n’as pas le droit de fuir comme ça.
Elle a sur le visage un masque de sérieux étonnant. Je la contemple un moment, bouche entrouverte : ses yeux noirs, ses sourcils rendus droits par la tension, ses épaules serrées dans une posture de défense, ses poings crispés. Puis elle sort, probablement pour pleurer. Sourd à ses récriminations, je me retourne vers ma page, et je regarde Antoine. Une femme mûre, une Andalouse folle de jalousie et prête à tuer pour lui, vient de le rejoindre.
* * *
Ma page s’ouvre sur un monde merveilleux et inconnu. La sensation de liberté me grise et me porte à lancer d’emblée les colonnes et les tours de mon monde imaginaire bien plus haut que d’habitude. Antoine est un explorateur qui s’enfonce dans une forêt inextricable, probablement tropicale, une jungle hostile et luxuriante. Je lève mon verre à la santé d’Antoine, qui se retourne pour me gratifier d’un clin d’œil complice. Nous nous enfonçons dans les fourrés, moi la plume à la main, dessinant au fur et à mesure les troncs torturés et les racines aériennes qu’il gravit, coupe et franchit, trois pas derrière moi. La forêt est un labyrinthe végétal et mental, j’en suis le jardinier fou et exalté. Je n’ai guère en tête le trajet, ni le but que nous atteindrons, mais je veille à ne pas trop m’écarter des voies du vraisemblable. Malgré mon élan, je sais être raisonnable. Je bois une nouvelle gorgée et la partage avec Antoine.
* * *
Je me lève et me presse jusqu’à la cuisine. Le vin me donne faim, et je ne veux pas en subir les effets trop vite. Je cours presque jusqu’au réfrigérateur, je n’y trouve rien qui vaille. Des petits pots entamés, des légumes en masse, des fromages pré-emballés, des plats cuisinés par ma femme et mis en tupperware. Je referme la porte, je me rabats sur la huche à pain. Une miche fraîche de l’après-midi y attend le petit déjeuner de demain matin. Je la prends, ainsi qu’un couteau à dents. Je retourne à mon bureau enfumé. Au passage, debout dans la chambre, je vois ma femme. Elle pleure en tenant la petite. Je lui fais un geste vague sans m’arrêter, un geste qui signifie « j’en ai pour peu de temps, j’ai bientôt fini, j’arrive, j’arrive ». Je m’enferme dans mon bureau, avec mon pain.
* * *
Je tends à Antoine une large tranche à la croûte bien craquante. Il l’engloutit.
Il est temps que l’histoire commence. Nous dévalons une pente raide et nous débouchons sur une scène insolite. Entre deux bosquets touffus est dressée une longue table. Lourde et massive, d’un chêne noueux et dense, elle porte des mets de choix entassés et fumants. Des servants s’affairent autour de dessertes et de tréteaux, préparent le vin, l’eau, le pain, les sauces. Un large feu craque et souffle, près de broches et de marmites. Les convives de cette assemblée s’empiffrent avec bruit, devisent avec entrain, dansent et chantent.
Antoine s’arrête derrière un arbre, près de moi. Je le sens inquiet. Moi seul sais ce qui peut advenir. Mais Antoine est un homme, il connaît la crainte. Je le rassure d’un sourire et je lui tends la main, en lui montrant la tablée.
Je retourne mon attention et ma plume vers la scène de festin, et je détaille les invités. Ce sont, en fait, des porcs déguisés en humains. Leurs yeux sont sombres, aveugles ; leur groin énorme frotte la table en rendant un bruit liquide et fouaille au hasard les plats, renverse les carafes, brise les bols de sauce. Ils grognent et font frémir leurs babines grasses sur leurs dents jaunies. A terre, quelques chiens faméliques se disputent les restes et les coulées de sang ou de sauce.
Malgré la frayeur et l’incompréhension d’Antoine, je nous conduis jusqu’à la table. Je veux savoir ce qu’il peut advenir de cette étrange situation. A notre arrivée, un haut personnage malingre se lève et nous ouvre les bras. Une tête de gallinacé déplumé, rachitique, aux yeux énormes, surplombe un cou qui n’est qu’un sac de peau pendante et qui s’agite horriblement. Il porte une longue robe de bure grise élimée. Sa voix criarde s’élève au-dessus des clameurs de la fête :
- Messieurs, messieurs, un peu de tenue, je vous prie. Nos invités d’honneur sont arrivés. Prenez place, mes jeunes amis.
Tous les porcs font silence et dirigent leur regard mort vers nous. Antoine s’inquiète, Antoine regarde autour de lui. Antoine est brave, mais c’est un homme. Antoine aperçoit la glotte des porcs remonter tandis qu’ils avalent les derniers morceaux glaireux de leurs plats.
- Ravivez le feu !
Je me tourne vers les sous-bois. De quelques traits, je fais une armée de serviteurs véloces, en livrée noire, qui viennent disposer des bûches sur le foyer déjà rugissant.
Antoine fait le premier pas vers notre hôte. Le volatile pose ses pattes sur les épaules larges d’Antoine et braille :
- Eh bien, vous devez être le jeune Antoine, n’est-ce pas ?
Il le place à son côté, sur un vaste siège de corne et d’argent. Puis il se retourne vers moi et ouvre à nouveau les bras.
- Et vous devez être Jean. Venez nous rejoindre, je vous prie. Vous êtes le dernier convive que nous attendions avant le début du Carnaval. Votre présence nous fait honneur. Vous êtes le seul digne de présider à notre fête.
Je rejoins le siège que je lui fais m’indiquer, un trône de porphyre et d’ébène, incrusté d’or et d’aigues-marines, en riant largement. Le volatile claque l’une contre l’autre ses maigres pattes :
- Allons, que le défilé commence sans plus attendre !
Tandis qu’un échanson nous sert à boire, à Antoine dans un calice de verre opaque, à moi dans un haut vase d’obsidienne sculptée en crâne ouvert, les chiens se mettent à aboyer, pleins d’une colère qui me surprend moi-même.
Quatre humains apparaissent, maigres, tremblants, dont l’un pousse un orgue de barbarie bancal. Ils avancent en se dandinant et en jouant de pénibles bouffonneries jusque devant la table, suivis par quatre lanciers qui pointent leur fer étrange, fendu en son milieu, entre leurs omoplates. L’assistance se met à glapir, les mâchoires claquent et les gorges rendent un chœur de gargouillements et de cris révoltants. Je sursaute, de plus en plus inquiet. La musique s’accélère, sous l’impulsion des lanciers, ses fausses notes se fracassent en un amas incompréhensible. Je m’aperçois que les lances inscrivent un chiffre, que je ne comprends pas, dans le dos des musiciens, leur tatouant une sorte de X majuscule enjolivé, sanglant. Le jeu m’amuse beaucoup moins, mais Antoine paraît serein.
Le maître de cérémonie se penche vers nous et je vois que plusieurs mouches s’affairent au coin de ses yeux globuleux et gris. Il nous confie :
- Ce ne sont que des hérétiques capturés sur les marches de la terre d’Eidôlon, ne craignez rien. Les chiens connaissent les traîtres et manifestent leur déplaisir, mais rassurez-vous : il n’en ont pas après vous.
Antoine hoche la tête d’un air entendu et tend la main vers les victuailles. Avec horreur, je me rends compte tout à coup que les viandes molles et suintantes grouillent de vers blanchâtres. Des nuées de mouches tournoient autour des membres à moitié cuits. Antoine n’en fait aucun cas et avale cette manne répugnante sans sourciller. Il se sert un autre verre d’un vin visqueux et chargé de caillots.
- Jean, servez-vous. Vous êtes notre hôte et notre Roi.
- Merci… Non. J’ai ce qu’il me faut. Je vous remercie.
* * *
Je balaie de la main les quelques miettes tombées sur ma feuille, et je mâche presque frénétiquement la part de croûte que je viens de déchirer. Il me fallait un aliment solide, sain, véritable, pour contrecarrer ces horreurs. Je le fais passer avec un nouveau verre de Côte de Nuits, puis je rejoins Antoine dans la forêt obscure.
* * *
Après les musiciens hérétiques, une cohorte de flagellants passe l’orée de la clairière et vient à nous. Des porcs nus, gras à souhaits, suant et couinant, s’expédient de grands coups de fouet dans le dos. Un prêtre mutilé coiffé d’une mitre en papier les mène. Il est nu lui aussi, et couvert d’excréments. Il caquète des imprécations que je ne comprends pas, en pointant son doigt répugnant vers moi. Des femmes-poulets, nues comme tous les autres, se traînent et rampent à quatre pattes, en répétant les cris stridents du prêtre. Leurs seins sont déformés par des tumeurs ouvertes, et ballottent sur leurs ventres gonflés. Deux d’entre elles se détachent du groupe et vont disputer leur pitance aux chiens. A la suite de ce cortège arrive une jument dépecée aux yeux fous, qui court par bonds incohérents de droite et de gauche, portant sur son dos un humain lié, coiffé d’un sac de jute sale, et gémissant de terreur. Le maître de cérémonie, bras en croix, se redresse soudain, et hurle vers le ciel :
- C’est elle ! La Salope Incroyante ! A mort la Chienne, à mort l’Infidèle !
A ces mots, tandis qu’Antoine observe la scène avec un air amusé et curieux, les convives sautent de leurs sièges et se jettent sur la jument, toujours bondissante. Ils précipitent au sol la femme liée et la frappent de toutes parts. Je n’aperçois plus le corps de la victime, j’entends seulement ses pleurs. J’entends le bruit sourd des pieds écrasant son ventre, faisant éclater ses organes, des dents forçant les articulations, brisant les os, démettant les genoux, des langues allant fourrager dans les cavités oculaires, violant sexe et sphincter, arrachant les boyaux sortis du ventre ouvert.
Les lanciers plongent leurs armes dans les flancs et à travers le crâne de la jument, qui s’effondre en frissonnant, cervelle broyée et nerfs sectionnés. Un sang lent et gâté s’écoule de ses plaies et s’étend en tâche noire sur la terre meuble.
Je veux à tout prix quitter cet endroit, et faire cesser tout cela. Je me lève à moitié et j’adresse à Antoine des grimaces de panique, mais Antoine est courageux. Antoine est fort. Antoine est assis et contemple ce spectacle de Carnaval morbide en buvant son vin grumeleux. Le maître de cérémonie, devenu comme fou, en bougeant en cadence, s’approche des porcs qui broient et déchiquètent la femme. Tous les êtres alentours sautent et se tordent en rythme, en même temps que lui. Antoine commence à battre des mains en souriant, d’abord timidement, puis de plus en plus enthousiaste. Et pour donner le point d’orgue de cette folie dionysiaque, le maître de cérémonie écarte les porcs, saisit la tête de la morte dont le sac a été arraché, défigurée et déjà à moitié dévorée, et la sépare du corps d’un coup de bec sauvage.
Je reconnais sans peine celle qui fut ma femme.
- Bouffez-la !, hurle le maître de cérémonie, les yeux révulsés, en jetant la tête coupée sur la table entre Antoine et moi.
* * *
Je sursaute, je m’écarte de mon bureau et d’une main tremblante, je déchire un morceau de pain et me ressers un verre de vin. La bouteille est presque vide, et j’en renverse un long trait par terre, involontairement. Je jure d’une voix sourde et mal assurée ; j’ai l’impression qu’on m’écoute, qu’on guette mes paroles et mes mouvements. Je mâche la mie, j’insiste, je redouble d’efforts, jusqu’à me faire mal aux gencives et à la base des dents, jusqu’à écraser les racines de mes molaires sous la pression. Je veux sentir ma bouche, je veux revenir. Le vin me brûle la gorge, tant mieux, je l’avale avec davantage encore de précipitation, pour qu’il m’agresse les muqueuses le plus possible, qu’il me réveille, qu’il me sorte de cette horreur. Je conserve une impression d’irréalité, comme si les objets étaient insensiblement plus loin que ce qu’ils devraient être, les sons moins forts, les lumières plus étouffées. Tout me fait peur.
Soudain je vois un point bouger dans la miche. Je m’approche et je vois, blanc et bien découpé, un asticot se tordre au sein même de la mie. Je frissonne d’horreur, et je secoue le pain au-dessus du sol, en le tenant à bout de bras. Trois bâtonnets blancs et mouvants en tombent. Je me penche : ce sont trois vers. Je me relève d’un bond, et je rejette le pain au loin. J’ai soudain l’impression de sentir de petits mouvements dans ma gorge, pas encore dans l’estomac, mais derrière la glotte, et dans l’intérieur du cou. Des tortillements. Je pousse un cri, et je me précipite sur mon verre, que je vide aux trois quarts, d’un trait. Je m’arrête avant la dernière gorgée : je viens d’avaler quelque chose de gluant et de ferme. Je regarde au fond de mon verre, sombre dans la semi obscurité de la chambre : des cocons noirs et lie de vin, gros comme une olive, reposent au fond.
* * *
Je me retourne vers Antoine.
- Arrête de manger ces horreurs, et laisse cette tête atroce, ne mange pas ça, j’ai du pain, du pain !
- Allons, il faut faire honneur à ces gens, et c’est le grand Carnaval.
- Arrête ça, je te regarde depuis tout à l’heure, tu te goinfres comme ces… porcs. Il faut que nous nous échappions. J’ai peur. Je ne maîtrise plus rien. Tout ça, c’est une folie !
- Tu n’aimes pas le spectacle ?
Il me regarde tout à coup droit dans les yeux et sans plus dissimuler son humeur il m’accuse ouvertement :
- C’est toi l’architecte de ces choses ! C’est toi qui m’as amené ici. Cette folie n’est que celle qui règne dans ton esprit et tu voudrais t’y soustraire ? Vois ces gens. Ils t’appartiennent, ils sont en toi, Jean. Eux te voient, eux me voient surtout, me reconnaissent. Ils sont tes enfants, et ma famille. C’est la nuit du Carnaval : il faut boire le calice jusqu’à la lie, rien ne peut se terminer avant que tout soit consommé.
Les porcs claquent des mâchoires et battent des pieds contre le sol puis, s’emparant d’Antoine, le portent en triomphe. Il rit aux éclats. Le maître de cérémonie, toujours à mon côté, déchire une large miche de pain rassis, juste sous mon nez, et la trempe dans une orbite vide de la tête de la victime.
- Partagez cette pitance avec vos serviteurs, ô Jean, Roi des Fous. Accordez-nous la foi et délivrez-nous de la maladie. Faites naître le carnage et le sang. Le processus est en marche ! Rien ne saurait l’arrêter !
Je hurle et me cache les yeux. Il faut que cela cesse, que cette folie cesse. Le maître de cérémonie a saisi un hachoir à viande et commence à frapper le crâne en cadence, pour l’ouvrir et en extraire la cervelle, mets de choix pour ses invités de marque.
* * *
Un battement, une secousse répétée, comme un battoir de bois sur le dos d’un supplicié. Plusieurs coups rapprochés, puis un répit, puis plusieurs coups rapprochés à nouveau. Comme une plainte, pour les accompagner. « Jean, Jean », un prénom que je reconnais. C’est le mien. Qui m’appelle ? Je…
C’est la porte. Quelqu’un frappe à la porte. Je m’écarte de mon bureau et de ma page, et je frémis en voyant le bois bouger sous les coups. J’ai l’impression de voir les vibrations, les ondulations des planches. Tous va au ralenti. Les coups viennent de loin, les sons n’atteignent pas mes tympans, mais un second tympan d’ouate juste devant celui de chair. J’ai peur.
Je saisis la bouteille vide et je me lève. Je cours jusqu’à la porte et je l’enfonce d’un coup de pied. Un corps mou est heurté par la porte arrachée de ses gonds, et tombe au sol, avec un cri aigu. Je ramasse la porte et la jette par dessus le corps. C’est la femme mise en pièce par les porcs.
- T’ES MORTE, T’EXISTES PAS !
Elle hurle et me regarde avec des yeux d’animal. Elle a un enfant entre les bras, qu’elle essaie de cacher sous sa poitrine. Elle hurle et hurle encore, sans s’arrêter.
- TU ES MORTE, TA GUEULE, TU ES DEJA MORTE !
Je la frappe, de toutes mes forces, et la refrappe, coup après coup, sur le crâne, sur les avant-bras qui essaient de protéger son crâne ou l’enfant, sur la nuque, sur le dos. Je ne m’arrête pas. Je la frappe et elle crie tant et plus. La colère me prend. Elle est morte, elle doit être morte. Je brise la bouteille contre le carrelage, et je recommence à frapper la femme avec le tesson, sur le crâne, droit contre le visage qui se retourne vers moi, dans les yeux, de côté pour arracher le nez, dans le mou des flancs, aux poumons plusieurs fois, pour déchirer la peau du dos qui couvre les côtes, puis encore au côté, sur le crâne, en tirant à chaque fois de larges lambeaux de peau. Je me relève et je lance des coups de pied furieux dans le dos de l’enfant qui gémit sous elle, dans sa tête inepte, il n’existe pas, il est mort, né d’une morte, il n’existe pas. Je reprends la porte et je la dresse verticalement, puis l’abats comme un pilon sur le crâne de la femme, qui finit par céder après une vingtaine de coups. Je continue à frapper en rythme, puis je pousse la femme du pied et je la retourne, découvrant l’enfant inconscient. Il n’a guère plus de sept ans, sa tête éclate bien avant celle de sa mère. Je finis de mêler leurs yeux à leur cerveau à coups de talon.
Puis je jette la porte sur eux, et je retourne à mon bureau, en les regardant avec colère.
Une voix continue à appeler mon nom, diffuse et indistinte. « Jean, Jean… » La colère retombe et j’ai peur.
* * *
- Vous vous rebiffez, vous, le Roi des Fous ? Notre festin n’est pas assez bon pour vous ?
Le maître de cérémonie à cessé ses coups et prend un air interrogateur et froissé.
- Bien. Je suppose que cela signifie la fin de votre règne et de notre soumission à vos commandements. La couronne des conjurés devra revenir à votre plus proche parent, Antoine.
Les serviteurs en livrée surgissent de nulle part, et avant que je les aie vus arriver, ils entourent déjà Antoine, se mettent à le cajoler de leurs mains gantées, lui caressent le cou, les bras, l’entrejambe. Lui les laisse faire en riant toujours. Il les regarde dans les yeux, passe ses mains dans leurs cheveux et refuse ostensiblement de m’accorder un seul regard.
- Non ! Je suis des vôtres, je suis votre architecte, votre Roi, vote créateur ! Vous ne pouvez pas me faire ça, vous ne pouvez pas me préférer Antoine, Antoine n’est rien, rien sans moi, je l’ai créé, il n’existe pas, moi seul existe !
Antoine se met à ricaner en me regarde, d’un air agressif et mauvais. Il se gave de la matière qu’il tire de la tête de la femme, cortex, liquide translucide et sans mêlés. Le maître de cérémonie dépose une couronne de verre sur sa tête.
Puis il éclate de rire.
* * *
Je tremble devant ma page. Mes lettres sont devenues immenses et indéchiffrables, même par moi. Pourtant ma main continue à s’agiter. Je ne comprends plus rien. Dans l’écran noir, un visage livide et creux me regarde, sans expression aucune. Il semble psalmodier mon nom. « Jean, Jean, Jean Delesquif, Jean, Jean Delesquif, né le dix-huit février mille neuf cent quatre-vingt, Jean Delesquif, Delesquif, Jean, Jean, Jean Delesquif, né le dix-huit février mille neuf cent quatre-vingt à Malbosc, Lozère, Jean Delesquif, Jean ». Des voix m’entourent, elles proviennent des murs, de juste sous la peau des murs, de partout. Les murs me grattent, j’ai envie de les déchiqueter, je me jette sur eux et je m’arrache les ongles à tenter de défaire des voiles d’illusions. Je crie pour couvrir les voix, mais les voix crient encore plus fort que moi, en cadence, « Jean Delesquif, Jean, né le dix-huit février mille neuf cent quatre-vingt, Jean, Jean Delesquif, Jean Delesquif, Jean, né le dix-huit février mille neuf cent quatre-vingt, Jen Delesquif, à Malbosc, Lozère, Jean, Jean Delesquif », toujours les mêmes mots, les mêmes voix, tandis que des animaux volants commencent à passer dans les coins obscurs de la pièce, en sifflant doucement contre l’air mouvant, des animaux venus et noirs, comme des chauves-souris sans yeux, mais à chaque fois que je tente de les voir, elles ont déjà fui. J’ai peur. Je hurle, et je commence à me frapper le crâne contre les murs. Qu’ils cessent. Que les voix se taisent.
* * *
Je me réveille soudain affalé sur la table du banquet, sans comprendre ce qui s’est passé. Plus personne. Je suis seul au milieu d’un amoncellement de chairs putrides, de plats et de verres cassés, de vomi et de déjections.
Je me lève d’un bond, et je cours au hasard. Il faut que je les retrouve. Il faut que j’arrête tout ça. Et j’ai peur.
Une nuée de torches, au loin, m’indique où courir. La forêt s’achève sur une large plaine hirsute, couturée de tranchées, plantée de lances brisées ou non, portant des cadavres froids éparpillés à perte de vue, ouverts, empalés, écartelés. Le cortège avance au milieu de tous ces décombres d’un pas allègre et sûr, vers au-delà de la plaine morte. Je suis leur trajet, en étant obligé de suivre des détours chaotiques. J’escalade une colline rocailleuse. D’en haut, alors qu’ils sont déjà redescendus, j’aperçois la silhouette d’Antoine, Antoine le fort, Antoine le Roi, assis sur le trône de porphyre et d’ébène porté par quatre porcs. Je dévale la pente en trébuchant cent fois, en m’écorchant cent fois aux armes abandonnées au sol, en glissant cent fois sur des plaies ouvertes et des membres séparés des corps. Je veux qu’Antoine descende de ce trône qui m’appartient, à moi, leur créateur. Je veux qu’ils meurent. La colère monte à mesure que j’approche, et ma haine fait lever des nuées de sauterelles autour de moi, tandis que les morsures des vers sur les chairs raidies des cadavres rendent un vacarme aigre et presque inaudible à force d’être aigu.
Je les rattrape après qu’ils sont entrés dans un grand corps de ferme abandonné. Au fond, une église, devant l’église, un cimetière. Sur l’église, pas de croix, un X majuscule. Je cours droit aux portes de la demeure sacrée, je les enfonce d’un coup de pied. Je manque tomber dans ce qui s’avère n’être que l’ouverture d’un immense escalier en colimaçon, qui descend au cœur de la terre. J’entends des voix indistinctes, qui psalmodient ou prient. Je descends en courant, en trébuchant plusieurs fois, en me cognant au mur extérieur. Les voix se font plus distinctes, elles hurlent un nom, le nom de leur Dieu, de leur Roi. « Antoine, Antoine, longue vie à notre Maître, Antoine ! » C’en est trop. Plein de haine et de colère, je prends une profonde inspiration et j’ouvre la porte, qui claque contre le mur.
* * *
Tandis que tout s’accélère autour de moi, et que les hurlements m’assourdissent, je serre mes poings contre mes oreilles, je plonge mes ongles détruits dans les cartilages, je serre jusqu’à sentir le sang couler dans mes paumes et sur mes joues.
Je gémis sans respirer, et je retourne à ma table, le dos courbé, pour me protéger des volants, qui tentent de me dévorer le crâne, comme ils l’ont fait avec ma femme, probablement. Je viens de la retrouver devant la porte, le visage détruit, le dos découpé, les côtes à nu et brisées, à côté de ma fille, méconnaissable, sa tête mise en bouillie.
Je me rassieds et je saisis ma plume, en me protégeant le front de l’avant-bras gauche. Je dois les tuer. Ils faut qu’ils meurent. Et Antoine avec eux. Je dois les tuer.
* * *
Antoine est au centre d’une vaste crypte éclairée de bougies et parcourue en tous sens par des chauves-souris aux dents acérées. Devant Antoine se tient le maître de cérémonie, à genoux, penché sur un cadavre de fillette, dont il a ôté la tête pour la remplacer par une tête de porc. Il est en train de recoudre la peau du cou, et la fillette commence déjà à couiner et à baver.
Antoine est absent, comme en lui-même. Les porcs sont tous sur le pourtour de la crypte, et en rangs au fond de la salle, aplatis contre les dalles, en pleine adoration et psalmodiant toujours. Mais le maître de cérémonie se retourne vers moi, calme et nullement surpris par le claquement de la porte.
- Le retour du frère ennemi, n’est-ce pas ? Eh bien je suppose que la cérémonie ne pouvait être parachevée sans vous, Jean. La passation des droits intemporels et éternels réclame votre présence. Notre maître Antoine vient de prêter serment d’allégeance à notre cause et de lier son destin au nôtre. Sacrifice humain fut fait selon le rite.
Je me précipite sur lui et, d’un trait de plume, je sépare la peau de son cou de sa carcasse grêle. Je brise son bec, je fais éclater son thorax, et je disperse en un instant ses entrailles autour de moi. Il a le temps de paraître surpris ; et légèrement amusé. Puis il s’effondre, défait, dans un dernier ricanement.
- Antoine ! Suis-moi ! Sortons d’ici ! C’est ta dernière chance !
Il me regarde sans un mot, et sans aucune réaction. Puis il commence :
- Le royaume d’Eidôlon est né. Le sang qui a été versé consacre à jamais son existence réelle. Tu t’es enfermé toi-même dans ce que tu as créé, et tu m’en as fait Roi. Eidôlon a éclaté comme un utérus trop plein et son contenu pourri contamine le ciel. Tu as ensemencé de ta complaisance le terreau de ta folie. Apprends-le à tes dépends. Le rite doit s’accomplir. Tu es mort. Tu es déjà mort.
Aussitôt une foule de corps tombe sur moi. Les porcs me jettent à terre, m’arrachent ma plume et me bourrent de coups malgré mes efforts pour me défendre. Je perds pied.
* * *
Lorsque je reprends connaissance, je suis reclus dans un cachot blanc et sans fenêtre. Mon éveil provoque des bruissements à fleur de mur. Je ne suis pas seul, j’en suis sûr, je sens des présences mouvantes et susurrantes tout près de moi. Avant que j’aie eu le temps de les chercher alentour, le claquement de la serrure de fer retentit. Antoine apparait dans l’embrasure de la porte, et le suivent trois hommes à tête de porc et costume rose comme la chair des porcs, visiblement avides de me palper et de me mettre en lambeaux. Je bondis sur mes pieds, et je hurle à toute force. Antoine sourit, mais les hommes à tête de porc paraissent effrayés, et reculent près de la porte.
- Antoine, fais-les partir, libère-moi, je t’en supplie ! Reviens, retournons à la maison, je n’en peux plus !
Il me parle doucement, ses yeux plantés dans les miens, pendant que les trois hommes à tête de porc nous observent de loin en chuchotant entre eux.
- Il n’y a plus de maison, il n’y a plus de famille. Plus rien de ce que tu as connu n’existe. Tu as entendu le maître de cérémonie, le rite a été parachevé, sacrifice fut fait de ce qui te liait à ton ancienne existence. Dévorée, ta femme, et passée aux rangs des porcs, ta fille. Tu l’as vu, n’est-ce pas ?
Je ne réponds pas. Les hommes à tête de porc préparent quelque attaque commune, près de la porte, en me regardant de travers.
- Je vais te laisser là, avec les porcs.
- Non…
Je tombe en sanglotant, mes jambes ne me soutiennent plus. Il s’agenouille près de moi et me tapote la tête comme à un animal :
- Brave bête, Jean, brave bête… Calme… Chacun son tour, chacun son heure. C’est mon tour, Jean. Je t’écrirai, désormais, je serai maître de ta vie et de ton destin. Les traits de ma plume te tortureront les viscères à ma guise, je déformerai tes traits et ton esprit selon mon bon vouloir. J’entre de plain pied dans mon règne et je n’ai plus rien à te devoir. Désormais, tu m’appartiens. Mais parce que j’ai pitié, et que tu ne m’intéresses en rien, je vais te laisser à ton sort, sans te torturer davantage. Les hommes à tête de porc te guettent, Jean, ils te reniflent et s’apprêtent à te saisir. Je leur laisse ce plaisir. Ils s’attaqueront à toi en groupe, d’un coup, sans que tu aies pu le prévoir, et tu n’auras plus assez de force pour les repousser. N’oublie pas, Jean, lorsqu’ils t’auront saisi, de leur crier ton histoire. Parle-leur de moi. Dis-leur, pour les porcs, les chauves-souris et les voix. A défaut de te sauver de leurs mains, au moins, tu les feras peut-être rire. Je reviendrai te voir et compléter mon œuvre, peut-être, si le cœur m’en dit. A bientôt.
Lorsqu’il sortit de la pièce, les trois hommes à tête de porc se précipitèrent sur lui, et plongèrent dans son corps une nouvelle giclée de narcotique.
LA ZONE -
/ Rubriques / Serial Edit
![[illustration]](/data/img/images/clockserialedit.jpg) Textes précédents :
Textes précédents :- Extrait de l'Apocalypse
- Apocatrip par Nounourz
- Sainte-morphine par nihil
- Le fils spirituel par Glaüx
- Sous terre par Aka
- Lambda par Lapinchien
- Timebomb par Nounourz
- La grande peste par nihil
- Le grand soir par Glaüx
- Moi et les cons par Aka
- L'émissaire par Lapinchien
- Lycanthrope par Nounourz
- La fin de l'hiver par nihil
- Immaculée contre un mur par Glaüx
- Le travail c'est la santé par Aka
- Entretien d'embauche par Lapinchien
- Pornstar par Narak
- L'insignifiant par Nounourz
- La lune rouge par nihil
= ajouter un commentaire =
Les commentaires sont réservés aux utilisateurs connectés.

![[nihil.fr]](/assets/img/nihilique/btn-rouage.jpg)
![[imprimer]](/images/print.png)

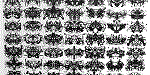




= commentaires =
Y a trop de lettres.
Moi j'aime beaucoup, mais vu que j'aime déjà beaucoup mon texte et que j'étais curieux de savoir ce qu'il en était advenu, je suis surement pas objectif. Je vois que tu as très bien compris mon texte et que tu as su exprimer ce que je voulais dire avec beaucoup de clarté et d'intelligence. Un énorme bon point pour l'histoire bien mieux construite que la mienne, notamment les retours à la réalité, et sur les interactions entre la réalité et le fantasme littéraire qui débordent joyeusement l'un sur l'autre.
J'ai deux objections de taille : l'histoire est exactement la même. Sur le début on s'en accomode bien en espérant des surprises pour la suite, mais il n'y a presque pas de surprise, l'histoire est quasiment la même de bout en bout, hormis une interaction plus poussée avec la réalité.
Et l'autre c'est que les scènes marquantes sont là aussi très semblables aux miennes, je veux dire, les porcs, l'homme poulet et toutes ces visions d'horreur sortent de ma tête, j'aurais pu apprécier que tu les remplaces par tes propres visions de branlomane frénétique. Là du coup, les scènes marquantes, bah c'est presque du déjà lu.
Mais quand même, bon texte. Très bien écrit, lisible. Les scènes les plus gore ont un coté un peu ridicule qui me déplait un peu (en fait dès que ça parle d'yeux, ça commence à faire Brain Dead) mais c'est pas trop grave.
Y a aussi deux petits moments où je me suis dit que ça aurait pu être mieux fait : le moment où il tue sa femme. On sait que le mec est un perturbé de première, mais de là à sauter sur sa gonzesse et la massacrer en hurlant qu'elle n'existe pas, je trouve qu'il y a un gros pas, que je voit mal franchi avec une boutanche de pinard et un petit délire littéraire.
L'autre moment, c'est presque pas ennuyeux, c'est à la fin quand Jean se réveille dans le cachot. A ce moment là j'aurais souhaité qu'il se réveille le lendemain chez lui, genre dans sa piaule, et pas dans un cachot imaginaire au fond de son esprit. Ce qui n'empêche pas des péripéties farfelues de survenirpuisque la réalité et le monde imaginaire ont clairement fusionné.
Satisfaisant, orgiaque, jouissif, pleinier.
Cependant Eidôlon a éclaté "comme un utérus trop plein", dommage.
La sentence d'Antoine est jubilatoire, bon sang ce que c'est bon serial edit.
Putain, on dirait le Antoine réel que je suis.
(Ouais ! Viendez tous me violer maintenant que vous avez mon prénom !)
Maintenant ça casse le mythe de savoir ton prénom.
Ouais on a toujours cru que ton prénom c'était abbé.
Sinon ce texte est vraiment incroyablement écrit. Et effectivement, je trouve les délires de nihil avec l'écriture de Gloups absolument jouissifs et je tenais à le signaler.
"Tu as ensemencé de ta complaisance le terreau de ta folie"
"Sinon ce texte est vraiment incroyablement écrit."
C'est vrai, en plus de trouver des textes sur ce site de tafioles, faut qu'ils soient écrits?
Ah ah.
"Sinon ce texte est écrit d'une façon vraiment incroyable".
Je traduis pour les gogols qui maîtriseraient pas très bien la grammaire.
HAHAAAAAAAAAAAAAAAA
Sur la grammaire tu m'auras pas, l'Abbé.
La grammaire ou ton égo indécent?
Parce que, si il n'y a que le deuxième obstacle entre nos deux êtres, je peux t'enculer, hein.
Best of de "Ce que j'en ai pensé à la lecture il y a plusieurs mois"
l : le café est une drogue
el gringo est un dealer
Best of de "Ce que j'en ai pensé à la lecture il y a plusieurs mois"
l : le café est une drogue
el gringo est un dealer
çà me fait penser au Bob Sinclar dans Le Magnifique...
à moins qu çà ne soit Antoine Decaunes avec ses costumes differents chaque soir à Nul part ailleurs... Mais ou est José Garcia ?
ouais je sais dans mon cul
Lu ce texte il y a quelques jours sur les conseils de Nihil. Sympa, très drôle. L'univers animalier confine au grotesque de Swift en beaucoup plus gore et déjanté. J'aime bien aussi le coup - relativement classique - de la créature qui se soulève contre son créateur. J'apprécie énormément l'aspect très visuel du texte.
Merci.
Bah de rien, moi si j'peux aider hein.