Faut que je boive. Je me relève en sursaut, les yeux écarquillés. Je fais un pas vers mon bureau, à un pas de moi dans mon taudis. Et je manque perdre connaissance. Chute de tension. J’ai le temps de tirer ma chaise, et je m’y effondre. Mon crâne continue sa course jusqu’au sous-main ; je sens la torsion de ma nuque, qui résiste sans que je puisse l’aider en rien. Ecroulé là, je reprends aussitôt conscience. Je n’ai pas renversé mon verre, ni la bouteille. Bourgogne Maison Dieu 1997, bordel. Ca m’aurait fait mal. J’ai déjà fini ma bouteille d’Armagnac avant le repas ; mauvaise soirée. Malaise depuis l’après-midi. Je suis seul et j’ai une peur incontrôlable de cette solitude. Une terreur qui dure depuis plus d’un an. Je me ressers mon cinquième verre de vin, après avoir fini le fond du précédent. Celui-là, je le bois en deux gorgées. Plus le moment de faire le noble et le connard d’amateur, mes papilles sont mortes. J’ai des fourmis dans tout le corps, et des sueurs froides qui viennent me faire des taches de malaise sous la surface de la peau. Mauvais trip.
J’ai laissé mon plateau bouffe à côté. Une assiette à soupe pleine d’une mixture à base de riz, un paquet entier, de gruyère, presque autant, et de sauce tomate. Couleur de gerbe. Une masse blanchâtre grumeleuse, avec un fluide jaunâtre qui la pénètre, et des veines rouges ou rosées. Mais j’ai tout fini. Froid, à la fin. Pour préparer ma nuit. J’ai mangé ça après la demi-bouteille d’Armagnac, ça commençait à appeler à l’aide dans mon estomac, fallait rétablir la solidité du truc. Je repousse le plateau, il me débecte. Comment peut-on accepter ainsi sa solitude et se préparer méthodiquement à en chier. Connard. Je balance aussi au mur la pile de feuilles blanches, et ma plume encore ouverte. Ecrire bourré. Beau projet d’idéaliste. Connard. Je prends le téléphone, puis je le jette au sol à son tour. Non, j’appellerai pas. Merde ! J’appellerai pas ! Je dois apprendre à me démerder seul ! Pas apprendre, continuer. Putain, je dis n’importe quoi. J’ai oublié si je veux me sortir de cette prison ou si je veux qu’on m’y laisse crever. En tout cas, j’ai le ventre qui se tord, à la seule idée de cette nouvelle nuit sans sommeil et sans personne.
J’allume l’ordinateur. Je me ressers un coup de Bourgogne, pendant qu’il se lance. Il doit me rester deux verres à peine dans la bouteille, merde. Et seulement trois heures vingt. Je passe sur le net. Trouver de quoi m’occuper. Le virtuel, c’est de la merde en boîte, mais c’est mieux que rien. Je fais trois forums. Déserts, ou bien des invités aveugles et muets. Je n’ai pas envie de passer aux messageries instantanées, j’en ai pas. Pour parler à qui. Merde. Je traîne sur tous les sites que j’ai en favoris, ça me prend moins d’une demi-heure pour me rendre compte que rien ne sert à rien. Je tourne en rond. Tout est mort, personne n’est là, ou bien des fantômes d’humains. Je cogne contre l’écran. Je crois qu’au fond de moi, ça se voulait une réaction désespérée contre cette frontière froide et plate. Mais ça se solde par un mouvement débile de demi-portion, et un poignet qui fourche.
Il est quatre heures moins le quart, et je suis à nouveau accroupi contre le placard. Je sais que les oiseaux, ces enculés d’oiseaux, n’arriveront pas avant au moins une heure trente, en cette saison. Et la lumière, bien après eux. Et les gens, la vie, la chaleur, encore après. Et encore. Je ne les connais pas, les passants. Tenir jusqu’à huit heures. A huit heures j’irai me réfugier dans le supermarché. Il y a toujours du monde dans le supermarché. Et des caissières souriantes, contentes de pouvoir un peu sortir de leur boulot pourrave en regardant avec sympathie un inconnu. Alors j’aime le supermarché. Il ouvre à huit heures. Faut que je tienne jusqu’à huit heures.
Peut-être que j’ai oublié un site, ou deux. Je rallume l’ordi, l’unité centrale est à côté de moi, par terre. Juste le bras à tendre. Je me rassois, lentement cette fois. Ma mâchoire est si lourde et déglinguée par l’alcool qu’elle pend seule, et que je bave un peu. Je m’essuie du revers de la main. Je vais sur les sites les plus chiants du monde. Infos. Météo. Zoologie. Et tiens, la fac. Paf, là, je tombe sur le Providence. Putain. Y a un service d’aide psychologique à la fac ? Merde alors. Je chope le numéro, j’appelle immédiatement. Rien à foutre de ma voix, de mon état. Ils comprendront. Biip. Biip. Biip. Répondeur. Le centre est ouvert de dix heures à dix-huit heures, merci de rappeler. ENCULES ! Merde. Je vide la bouteille, mon dernier verre de celle-là. Je sors la boutanche de cognac qui traîne dans mon placard. Je rappelle. Je laisse un message pour demander un rendez-vous à un psy, putain, je suis plus à ça près. Ca me fait limite du bien de parler à cette chiotte de répondeur. Je raccroche, je vide mon verre. Trop vite. Le cognac me fait comme une brûlure, en distendant les tissus à vif de mon œsophage. J’ai un hoquet, je manque gerber sur mon clavier. Goût de bile et d’alcool sale. Je ravale le peu qui était passé. Puis je monte à l’étage en m’accrochant péniblement à l’échelle de meunier, et maintenant que je suis lancé, putain de merde, et au calme là-haut, j’appelle ma seconde meilleure amie. La première, c’est mon ex, pas la peine. Répondeur. Tu m’étonnes, il est plus de quatre heures et elle bosse à huit. D’accord. Texto. Le texto le plus pathétique et nul de ma vie. Appel à l’aide en bonne et due forme. Inepte. Elle l’aura demain à sept heures, enfin dans trois heures, il peut se passer pas mal de choses en trois heures. Un second ensuite, pour compléter. Puis je repose le portable.
J’écoute. Toujours pas d’oiseaux. Toujours pas de voix, personne, nom de Dieu, personne. Je suis assis sur le bord de mon lit vide. Avec mon portable inutile à côté de moi. L’unité centrale qui souffle en bas. L’halogène qui envoie un faisceau blanchâtre à travers la trappe, et alentour une espèce de transparence luminescente et noire à la fois. Comme si même la lumière faisait écho au vide de la nuit. Putain de solitude.
Je regarde l’heure : même pas quatre heures et demie. Et plus aucun moyen de m’en sortir. Je me tiens le ventre à deux mains, en me penchant contre mes cuisses. Je recommence à geindre, sans pouvoir me maîtriser. Et à me balancer. Mes pensées suivent le rythme de ce balancement, et du cri étouffé. Elles meurent lentement. Je tends la main au sol, pour ramasser la bouteille de cognac. J’y bois encore deux gorgées au goulot. J’ai déjà bu le tiers, tiens. Même pas remarqué. Ca passe tout seul. Peut-être que la solitude passe aussi, au bout d’un temps. Un temps qui doit être vachement long, parce que là, ça fait déjà plus d’un an, cette histoire. Je rebois une gorgée.
J’ai chaud et froid à la fois, et tout me démange sous la peau. J’ai soudain envie d’être torse nu. J’essaie d’arracher ma chemise de pyjama, je y échoue. Je la déboutonne à moitié, et je la quitte ensuite comme une tunique. Le mouvement me retourne l’estomac, et m’humilie. Connard, enculé de pauvre mec. Je mérite pas mieux que d’être seul comme ça. Qui tu veux que je voie, dans cet état. Et merde. Je recommence à me parler à la deuxième personne.
J’ai une furieuse envie de me gratter, mais de me gratter les muscles, les organes. De plonger en moi. Peut-être pour m’abstraire, pour me perdre dans les viscères et oublier que je suis seul, là, comme un con. Je racle frénétiquement mes côtes, j’essaie d’appuyer autant que possible. Je tire la peau de mon ventre vers l’avant, le haut, le bas, en tentant de blesser autant qu possible, que la démangeaison cesse. Ma mâchoire aussi me fait abominablement mal, à la jointure. Je commence à râler comme une carne. Et je sens mon regard se modifier. Putain. Faut que j’arrête. Je me relève. Je reste immobile debout, je me force. Je regarde mon corps. Je suis couvert de griffures et de bleus, déjà. Faut que je me calme. Faut que je m’en sorte.
Je me rassois, et je rebois à la bouteille. Une queue, peut-être ? Ca anesthésie, d’habitude. J’essaie. Hahaha. Queue d’alcoolique. Molle et pendante. Froide, même. Inutile. Elle, elle est déjà morte de solitude. Putain la chance.
Ma tête tourne, à présent. Les bruits sont au centuple. Le souffle de l’ordinateur, en bas. Mon sang, dans mes oreilles. Des craquements atroces, dans le sommier du lit, qui me prennent en traître. Je pose mes lèvres sur le goulot, mais je me ravise. Dans mon état, faut arrêter. Je suis seul, putain, je suis seul, mais là, je sens que mon calvaire prend fin. J’ai réussi à m’endormir l’intérieur. Un sourire essaie de se dessiner sur mes lèvres. Sais pas s’il va au bout. Je m’allonge sur le dos ; tout tournoie horriblement, droite, gauche, droite, gauche, j’ai des réflexes de la nuque pour rétablir l’équilibre à chaque fois. J’ouvre la bouche pour prendre plus d’air. Un temps infini pour passer le cap et accepter le changement de position. Je pars.
Je me réveille de l’estomac avant de me réveiller du cerveau. Un haut le cœur énorme. Comme un coup de tronc d’arbre dans le bide. Et en même temps, comme un poids de mille tonnes qui m’enserre tout à coup la cervelle. Rose sanglant et jaunâtre. Je vois tout en gerbe. Faut que je gerbe. Tout de suite. Je me lève d’un geste, je descends l’échelle de meunier sans précautions, je préfère me latter mais vomir en bas. J’arrive, je marche le plus vite possible aux chiottes. J’ouvre la lunette, je m’accroupis. Merde. J’ai envie de chier, aussi. Oh merde. Je me relève tant bien que mal, mais des hurlements me déchirent le crâne. Je m’assieds sur les chiottes, et je me penche au-dessus de mon lavabo en même temps. Il tourne et se balance. Mais il est juste à côté. L’avantage d’habiter dans douze mètres carrés. Je pousse, et j’attends.
Je chie, ça ouais, je chie. Mais pas de gerbe. Pourtant je sens la brûlure de toute la matière, comme en fusion, qui comprime les parois de mon estomac. Je finis. Tout tourne de plus en plus vite. Et des gens qui crient. Je me relève, je me retourne pour tirer la chasse. J’atteins la chaîne, et je tombe en même temps.
Je me réveille une seconde fois, avec une odeur de pisse froide dans le nez et un truc glacial contre les lèvres. Je suis courbé dans le mètre carré de mes chiottes, les jambes pliées, et le buste enroulé autour de la base de la cuvette, à gauche. La tête contre l’émail. J’ai la gerbe. Putain qu’est-ce que j’ai la gerbe. Et j’ai froid. Je crois que je suis seul.
Je profite du retour d’un peu de conscience pour agir avec mesure. Je me pousse avec mes bras pour glisser jusque devant le chiotte, sans me lever. J’attends le résultat. Même état. Je me relève sur le coude gauche ; ça passe. Tout s’éloigne un peu, les tons deviennent étouffés, mais je reste conscient. Je continue à me relever sur le bras gauche, et j’arrive à hauteur de la lunette. Je me penche au-dessus, et je pousse dans ma gorge comme pour gueuler. Fort. De plus en plus fort. Mais rien. Je respire, en haletant. J’ai le cortex qui tourne en boule et se tord dans tous les sens. Si seulement je pouvais le gerber aussi. Je recommence. Je pousse. Je crie, même, pour voir. Rien. Je me repose la tête contre la lunette. J’essaie de m’enfoncer les doigts dans la gorge. J’ai très peur de me faire mal : je ne maîtrise pas mes mouvements, et je ne sens presque rien, sauf un mal-être général. Avec ma main enfoncée dans la gorge, j’arrive à provoquer un premier hoquet ; je ressors ma main en vitesse, et je vomis. Un peu. Une gerbe ridicule. De la bile rougeâtre. Par contre, l’effort me fait crier les voix à l’intérieur, mille fois plus fort. Je m’écroule à nouveau.
Une troisième fois, je me réveille. Différent. Conscient à en être presque ébloui. Ou bien c’est le jour qui se lève. Couché au sol, des fourmis dans les jambes. Mais avec une maîtrise parfaite de mes mouvements, et de leur planification. J’ai juste très froid, et la même envie de vomir. Je suis lucide. Je me vois dans mon état. Je me souviens de mes lèvres entrouvertes contre les chiottes. Des odeurs de pisse. De la chasse dont je ne sais pas, finalement, si je l’ai tirée ou pas. Je sens la vieille odeur de chiasse, qui semble prouver que non. Je me souviens surtout des causes, et de ma soirée, et de ma nuit. Je me retrouve toujours aussi seul, allongé dans mes chiottes, seul, putain, mais là, il fait jour. Y a les oiseaux. Qui chantent leur chant de cons. Et la lumière aigre du petit matin. Quelle heure ? J’en sais rien. M’en fous. Faut que je gerbe. Que je me gerbe. J’en ai marre. Qu’on en finisse avec cette vie de merde. Je tente de me redresser ; inutile. Impossible. Trop lourd, aucune force. J’ai l’estomac qui brûle. J’allonge mes jambes. Douleurs. Les fourmis qui reprennent, et en plus le sang qui recommence à y circuler. Comme si on me les arrachait. J’ai dû rester longtemps là. J’ai soudain un spasme dans les boyaux ; j’ai le temps d’ouvrir en grand les yeux, et quand je tourne la tête sur le côté gauche, je suis déjà en train de me répandre. Une flaque énorme. Le riz, intact, comme en soupe. Un fluide dégueulasse et puant autour, mais ça pue pas la gerbe, ça pue autre chose, je sais pas quoi. Jaune, rougeâtre par veines, blanchâtre. Comme toute ma nuit. L’image de ma vie. Je suis trop faible pour bouger. Ma bouche reste ouverte, ma tête sur le côté, la gerbe sur le carrelage juste à l’entrée de ma bouche. Je respire ce que j’ai lâché. Je m’évanouis à nouveau. Je reviens à moi presque immédiatement, je crois. Et là, c’est comme si je retournais mon estomac à l’envers. Un autre spasme, qui me fait me redresser à moitié ; puis je m’effondre, et en retombant, je vomis tout le contenu de mes boyaux. Ce qui restait. Je tombe dedans.
Je suis si calme.
En paix avec moi-même. Mon crâne dans ma gerbe, du riz collé aux parois internes du nez, une odeur d’alcool et de bile partout. Tout ça me plaît. J’y suis bien.
Qui voudrait mieux qu’un monde à sa portée et qui lui montre sa propre image, partout, tout le temps. Plus de solitude. Je me suffis à moi-même.
Et puis, qui voudrait d’une larve à la peau transparente, incapable de rien faire sinon gémir, amorphe, et qui gît dans son vomi. Personne.
La solitude, je l’emmerde. J’ai dépassé ça. J’ai trouvé ma voie. Ce matin encore.
Je vais dormir un peu, à présent, ici. Puis je me relèverai, plus tard dans la journée ; je me doucherai correctement, et j’irai au supermarché.
Il me faut d’autres bouteilles.
![[illustration]](/data/img/images/cagealcoolo.jpg) Putain de vie de merde. Je reste accroupi au sol, en pyjama. Mains crispées sur mes chevilles. La tête enfoncée entre mes genoux. Je gémis sur un ton aigu, puis je me balance deux fois, et je me laisse tomber en arrière, contre le placard. Sur le faux parquet en plaques de lino. Je me recroqueville encore, comme attiré par le coin entre le meuble et le sol. Je voudrais m’y plonger, y disparaître. Non. Je voudrais que quelqu’un soit là, me tende la main, et me relève. Putain ! Mais quel con. Quel niais. Merde ! J’ai besoin de personne, je dois n’avoir besoin de personne ! Fait chier. Il est trois heures du matin, je suis fait comme jamais, mes potes travaillent, eux, ou dorment. Va falloir te démerder, cocotte. Jusqu’au jour. Putain de nuit.
Putain de vie de merde. Je reste accroupi au sol, en pyjama. Mains crispées sur mes chevilles. La tête enfoncée entre mes genoux. Je gémis sur un ton aigu, puis je me balance deux fois, et je me laisse tomber en arrière, contre le placard. Sur le faux parquet en plaques de lino. Je me recroqueville encore, comme attiré par le coin entre le meuble et le sol. Je voudrais m’y plonger, y disparaître. Non. Je voudrais que quelqu’un soit là, me tende la main, et me relève. Putain ! Mais quel con. Quel niais. Merde ! J’ai besoin de personne, je dois n’avoir besoin de personne ! Fait chier. Il est trois heures du matin, je suis fait comme jamais, mes potes travaillent, eux, ou dorment. Va falloir te démerder, cocotte. Jusqu’au jour. Putain de nuit. J’essaie de penser. Pas facile. Ecrire, impossible. J’ai essayé ; j’ai seulement réussi à commencer un vers. Un seul vers. Merdeux. J’aurais pas dû boire, pour ça. Mais même avant, ça passait pas. Et puis on ne peuple pas une vie avec des bonshommes de papier. Il faut que je pense. Faire du bruit dans ma tête. Trop de silence, ici. Merde !
J’ai gueulé. J’ai voulu gueuler merde, mais j’ai fait un truc entre le aaa et le èèè, raclé du fond de ma gorge. Je recommence à bouger d’avant en arrière, comme un dingue, en geignant. J’en ai marre. Faut que ça s’arrête. Putain ! Faut que ça cesse. Quelqu’un. Faut que j’app... non. Pas à trois heures. Je ne veux pas les déranger. Quand on a trois amis en tout et pour tout, on les soigne. J’ai trop peur de les déranger.
= ajouter un commentaire =
Les commentaires sont réservés aux utilisateurs connectés.

![[nihil.fr]](/assets/img/nihilique/btn-rouage.jpg)
![[imprimer]](/images/print.png)

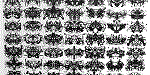




= commentaires =
Limite hors-sujet quand même. OK le narrateur noie sa peur de la solitude dans l'alcool, mais le sujet principal du texte, c'est pas la phobie, c'est l'alcool. Hors de ces basses considérations, c'est un chouette texte, bien effrayant à la Leaving Las Vegas (bon film d'ailleurs). Totale déchéance. Mais un peu lourd à force de s'arrêter sur tous les détails, ça fait un texte bien long où il se passe pas grand-chose.
Je suis d'accord avec Nihil, comme d'habitude. C'est assez glauque, je dirais.
Ouais ! on a Nicolas Cage sur la Zone en guest star d'illus çà le fait !
Putain Nicolas Cage utilise du déo, et en bombe en plus.
Merde alors.
Un mythe de la masculinité odoriférante qui s'effondre.
C'est vachement trop long, ouais.
En même temps quand tu te fais chier tout seul à crever, ça passe vachement lentement, le temps.
Mais on n'est pas là pour lire des trucs chiants. C'est un fait.
çà c'est bien un texte écrit par quelqu'un qu'imagine même pas ce que peut être une phobie
en effet, y'a pas grand chose de phobique la-dedans, mais c'est un excellent texte sinon.
"je passe sur le net. Trouver de quoi m’occuper. Le virtuel, c’est de la merde en boîte, mais c’est mieux que rien. Je fais trois forums. Déserts, ou bien des invités aveugles et muets. [...] Merde. Je traîne sur tous les sites que j’ai en favoris, ça me prend moins d’une demi-heure pour me rendre compte que rien ne sert à rien. Je tourne en rond. Tout est mort, personne n’est là, ou bien des fantômes d’humains."
--> du 100% vécu, à croire que l'auteur est venu lire dans mes pensées.
Rien à dire de plus, j'ai beaucoup aimé. Mais vu que ça ne parle (presque) pas de phobie, je ne voterai pas pour celui-ci. Dommage.
Nicolas il est trop kiffant sur la photo ! comment qu'il imite bien le niveau à bulle, c'est trop ouf !
J'avais pas fait attention au titre : c'est Solo alcool, pas "salo". Ca peut se changer ou je l'ai dans le cul ?
Ouais ça m'avait surpris aussi comme titre. Je le change.
Je te suis infiniment redevable dans la mesure de mes moyens et de ma profondeur rectale.
j'ai BEAUCOUP BEAUCOUP aimé
Mais enfin, mais c'est quoi ce pseudo.
Castor Obnubilé.
Ben justement, les descriptions des détails, j'ai trouvé ça très bien.
Ca me provoque le même effet que l'ambiant, avec des petits "cling cling" à droite, des petits "boum boum" à gauche, et puis des petites nuances de couleur, là, on s'imprègne bien. La panique est très bien retranscrite, je trouve.
Après, beaucoup de gens trouvent que c'est chiant, l'ambiant ; dans les faits il se passe effectivement pas grand chose. Moi, œstrogène vivant, ça m'a touchée.
J'arrive pas à croire que je viens de lire un texte aussi long et aussi monolithique, là, comme ça. Pfiou.
Le CMB s'impose sur les deux adjectifs de la dernière phrase.