C’est l’heure de l’épuration. J’ouvre en grand tous les placards de la cuisine et je déploie un sac-poubelle de cent litres à mes pieds. A l’intérieur, je jette sans distinction les boîtes de conserve, les paquets de riz et de pâtes, les condiments. Tout ce que ma main rencontre. Les bocaux en verre éclatent en heurtant le carrelage à travers le plastique, et leur contenu se mêle. Les liquides imbibent les sucres en morceaux, les emballages en carton, les céréales. Tous les aliments finissent au fond du sac. D’un geste, je vide la corbeille de fruits : les pêches fraîches, les abricots et les pommes s’écrasent dans le bourbier alimentaire. L’odeur mêlée des cornichons au vinaigre, de la confiture et de la sauce tomate monte à mes narines ; j’ai un haut-le-cœur, je manque vomir. Ce serait dommage. J’attrape le sac par ses bords et je le traîne tant bien que mal jusqu’au réfrigérateur-congélateur. Là, je poursuis ma tâche : les produits frais et les surgelés rejoignent la poubelle commune.
Je ne m’arrête qu’après avoir terminé. Je tourne sur moi-même, je regarde partout très attentivement, pour être sûr de ne rien oublier. Mais non, plus aucune nourriture dans cette cuisine.
Je referme enfin le sac-poubelle, devenu trop lourd pour être porté, et qui menace de se rompre. Je l’emmène jusque dans la cage d’escalier. Une fois arrivé en haut des marches, je le pousse du pied, et tout son contenu se déverse de degré en degré dans un fracas épouvantable. Avant la fin de l’écho de sa chute, et avant que les odeurs ne remontent jusqu’à moi, je rentre dans l’appartement, ferme à double tour, et d’un geste sec du poignet, je casse la clé à l’intérieur de la serrure.
Aujourd’hui était le jour de mon dernier repas.
***
Jour 1 - 8 heures
Le réveil sonne, j’ouvre les yeux. J’ai avalé un somnifère et un anti-inflammatoire avant de me coucher, pour prévenir les effets néfastes des deux bouteilles de vin blanc ingurgitées la veille au soir. L’éveil s’effectue normalement, sans inconfort particulier, j’ai juste la tête un peu lourde, une légère douleur dans le cou. Je fais quelques assouplissements, par habitude. Puis je me redresse, et je regarde autour de moi, dans la pénombre. Je n’ouvre pas les volets et je n’allume pas les lumières. Je reste là, les bras ballants, sans rien faire, jusqu’à ce que l’inconfort me pousse dans l’autre pièce.
Jour 1 - 11 heures
On a sonné deux fois à la porte. Assis dans mon fauteuil favori, je suis resté immobile. Au moment où j’ai pensé que c’était terminé, où la tranquillité se réinstallait en moi, un poing a frappé lourdement au battant, et j’ai sursauté. Je me suis terré dans le plus parfait des silences, retenant même mon souffle, en attendant que l’importun décide de tourner les talons. J’ai entendu un peu de remue-ménage dans la cage d’escalier, sûrement la personne chargée de l’entretien en train de ramasser mes ordures amoncelées.
Jour 1 - 14 heures
J’ai laissé la matinée s’écouler en silence. Volets fermés, le ventre déjà vidé des victuailles de la veille, seul et sur mon lit, je n’ai pas senti le temps passer. Je griffonne ces quelques lignes sans conviction. Je reste aux aguets, mais mon corps est presque silencieux, lui aussi. Pas de plainte. Quelques mouvements de désordre dans les premiers méandres de mon intestin grêle ; quelques bulles de gaz malséantes qui forcent la résistance du pylore ; rien d’important.
Il est 14 heures. J’aurais dû manger depuis deux heures déjà. C’est ce que la coutume prévoit et ce que la médecine et la diététique préconisent.
Je ne mangerai pas.
Jour 1 - 21 heures
J’écoute la radio d’informations en continu depuis tout à l’heure, sans que l’avalanche de mauvaises nouvelles ne vienne troubler ma sérénité. Les émeutes, les tueries, les grèves, rien de tout ceci ne m’émeut ni n’éveille la moindre réaction en moi. Après trois bulletins d’informations identiques consécutifs, j’éteins la radio.
La première pointe d’acidité s’est produite à 17 heures 43 précises. Une sensation de tiraillement dans la paroi stomacale. Je ne l’attendais pas si vive. Elle s’est calmée cependant, presque immédiatement. Un simple rappel à l’ordre sans frais. J’ai envie de fumer, mais c’est loin d’être obnubilant. Je me sens abattu, déprimé sans que rien ne justifie cet état. Je reste aux aguets.
Tout au long de l’après-midi, j’ai entendu la rue vivre, derrière les volets clos. L’habituel manège des voitures qui redémarrent au feu, les enfants qui braillent, les chiens qui jappent. Dans l’appartement du haut, des chaises ont grincé jusqu’aux alentours de 16 heures. Un repas de famille, sans doute. Evidemment.
Mon estomac gargouille fort maintenant, je n’ai aucune envie de manger ; mais je crois que mon organisme réclame sa pitance.
***
Jour 2 - 8 heures
Le réveil sonne, j’ouvre les yeux. Je n’ai rien à écrire, rien à dire. Assouplissements, errance imbécile dans les différentes pièces de mon appartement, anti-inflammatoires, deux ou trois, puis je me recouche et je reste assis dans mon lit, dans la semi-pénombre, les yeux grands-ouverts.
Jour 2 - 13 heures
Toujours rien. J’essaie de gommer de ma pensée les nombreux bruits qui résonnent derrière mes murs, mis j’en suis incapable. La circulation, les enfants, les chiens. Je ne maîtrise rien, chaque fois que je m’enfonce dans la torpeur méditative que je recherche, un nouveau fracas vient la briser. Le vacarme de l’extérieur contamine ma cellule. Je lutte, je compte les minutes, fixe mon attention sur ces lignes ou sur le motif récurrent de mon papier peint, mais rien ne fonctionne. On ne peut pas vivre en paix dans un monde tel que celui-ci. Tout n’est que tumulte, cris, agitation. Les chiens des voisins aboient sans s’arrêter. J’ai l’impression qu’ils me cernent, qu’ils se jettent contre les murs pour entrer chez moi. Je manque sortir de mes gonds. Je rêve d’une cave profonde et sèche, aux murs épais, un puits d’ombre et de silence dans lequel me noyer.
Jour 2 - 22 heures
Je viens de passer plusieurs heures, assis en tailleur, dans le noir désormais complet, à analyser cette impression de faim. Un appel purement organique, qui n’affecte en rien la pensée. Je peux maîtriser cette sensation. Elle n’est qu’annexe et je me sens capable de passer outre. Un petit centre agaçant d’inconfort en moi, et qui réclame toute mon attention, mais que je m’efforce d’oublier. Je me transporte bien au-delà du plan physique et de ses vicissitudes, bien loin de ces murs nus et de ces meubles bon marché. Je m’enfuis, je suis plus haut, je raye mes tracas organiques de ma mémoire pour rejoindre un monde de sérénité et de calme.
Je ne veux pas allumer la lumière, je ne veux pas me lever de mon lit. Je finis ma bouteille d’eau, accompagnée de deux gélules bleues de somnifère, et je finis cette page : dans le noir, je n’arrive plus à écrire.
***
Jour 3 - 8 heures
Le réveil sonne, j’ouvre les yeux. J’ai faim. Terriblement faim. Cette vacuité interne qui me ronge. Le manque de nicotine me ronge. J’ai mal à la tête et je sens mes nerfs à fleur de peau. Je me lève, et j’avale deux anti-inflammatoires, que j’avais préparés hier soir avant de me coucher. Ca a du mal à passer, à franchir la frontière. Je fais quelques assouplissements par habitude. Quand je me redresse, mon champ de vision se noie dans l’obscurité et je chancelle. Ce n’est rien, une brusque chute de tension. Rien d’anormal. Je me suis réveillé deux fois cette nuit, alors que ça ne m’arrive jamais, et ma nuit était emplie de présences malveillantes. J’ai pleuré et senti mes résolutions vaciller.
Jour 3 - 12 heures
L’inactivité me pèse et je déambule de plus en plus rageusement, d’une pièce à l’autre. Alors que je m’étais préparé pour un paisible voyage en moi-même, je me retrouve tournant comme un fauve en cage. Je suis allé inspecter le reste de l’appartement pour vérifier que tous les aliments ont bien disparu. Au salon, j’ai eu un haut-le-cœur en m’apercevant que la vaisselle sale était toujours sur la table. J’ai tout passé dans le vide-ordures, dans le désordre, sans me soucier du fracas de verre brisé.
Jour 3 - 18 heures
Je reste à l’écoute de mon organisme, assis dans mon fauteuil favori, les mâchoires serrées à m’en faire mal. Depuis hier, tout à changé. Le silence suspect de mes organes m’inquiète. Je contemple douloureusement mes doigts qui tremblent sur l’accoudoir. J’essaie de percevoir une forme d’activité en moi, un mouvement, mais tout mon corps fonctionne au ralenti. Je respire par grandes saccades et tente de plonger en moi, visiter mon intérieur. Je me retrouve entouré de mes organes flasques, je côtoie des artères grises comme des lombrics, je roule sous le poids des tissus, je glisse le long du câblage nerveux. Mais ma concentration est perturbée par les bruits intempestifs, de l’autre coté des cloisons. Mes voisins tirent leurs chaises bruyamment, j’entends des éclats de voix, des verres qui s’entrechoquent. Ma sérénité déjà sérieusement mise à mal vole en éclat et je me lève d’un bond. Je frappe le mur sans que le bruit de repas ne s’atténue. C’est comme une bande-son passée par un magnétophone à ma seule intention ; et le volume a été poussé à fond.
***
Jour 4 - 8 heures
Le réveil sonne, j’ouvre les yeux.
Depuis hier je reste des heures cloué dans mon fauteuil ou dans mon lit, incapable de dormir ni de faire quoi que ce soit. Ma seule activité consiste à multiplier les visites à la salle de bains. Boire des litres d’eau, mettre à mal mes réserves d’anti-inflammatoires.
Je fais quelques assouplissements, par habitude, mais je m’arrête entre deux flexions, frappé par l’absurdité de mes gestes.
Jour 4 - 12 heures
Chaleur moite, terriblement éprouvante. Il faut que je boive, j’ai tout le temps soif, à présent. Je me remplis comme je peux. Je n’ai plus d’envie, ni n’énergie pour rien d’autre, même écrire me pèse.
A la salle de bains, après avoir ingurgité je ne sais combien de pilules anti-émétiques et d’autres trucs, je me regarde dans le miroir. L’homme en face de moi est creux et gris, avec des orbites noircies et des yeux invisibles sous l’arcade trop prononcée. Ses mâchoires me causent une certaine gêne : crispées, avec deux fossettes dures comme la pierre aux commissures, et un léger retrait de la lèvre supérieure, comme de haine, ou comme après avoir vomi. Mes paupières tremblent, j’ai l’air d’un fou. Je ne suis pas fou. La peau est grise, affinée et sèche. Le corps puise ses réserves où il peut : les pores graisseux, c’est pour ceux qui mangent, pour tous ces putains d’obèses qui ne vivent que pour se remplir compulsivement, empiler les aliments encore et encore dans leur organisme d’animaux sédentaires. Ce sont eux, les fous, pas moi. J’ouvre la gueule en grand, adresse un sourire de loup à mon reflet. Les gencives sont rouges, sensibles et j’ai un goût de sang dans la bouche. Les dents sont grises et effrayantes. Je prends conscience de leur enracinement dans mon visage, de leur proéminence, j’ai l’impression que mon visage entier est construit autour d’elles. Anémie, vomissements répétés. Dévorer, déchirer. Il a l’air de s’en foutre. Je m’en fous. Je cherchais la sérénité des ascètes et me voilà changé en bête furieuse.
Jour 4 - 19 heures
Pris d’une rage sans nom, je déambule dans ma chambre, arrachant violemment les décorations stupides qui recouvrent les murs et les entassant dans un coin. Je pousse l’armoire, la table de chevet dans le couloir. Toutes ces choses stupides dont j’ai eu la faiblesse de croire qu’ils rempliraient mon néant. Mais mon univers n’est plus qu’un désert de cendres. L’effort manque m’envoyer dans l’inconscience et je m’arrête, essoufflé, jouissant misérablement du sifflement asthmatique produit par mes poumons, un rictus d’ironie aux lèvres. Mes côtes douloureuses, mes muscles défaillants, mes articulations endolories. Je me force à dépasser mes limites en envoyant la seconde table de chevet dans le couloir rejoindre la première et je m’abats, littéralement brisé, sur mon lit.
***
Jour 5 - 11 heures
Après trois heures à m’enivrer du bruit de ma seule respiration, d’autres sons s’insèrent peu à peu dans ma bulle, obsédants, loin derrière mes murs. Musique sourde dont je ne perçois que les basses, jappements aigus et répétitifs, marteaux qui cognent. Je ne peux plus vivre pleinement mon autarcie, ma sérénité est brisée. Je fais le tour de la pièce, nerveux, je cherche à localiser ces bruits qui me harcèlent. Je tape du pied, je hurle pour couvrir, mais rien à faire, je sais qu’ils sont là. C’est un poison lent qui a déjà accompli son travail de sape, plus possible de penser à autre chose. La lumière glisse dans la pièce en flots gris, ça me met en rage.
Jour 5 - 12 heures
Sans plus réfléchir, je me retranche dans la chambre, pousse les meubles devant la porte, dresse le lit contre la fenêtre. Je fulmine, je bouscule les objets de plus en plus violemment contre la fenêtre et les deux portes pour solidifier mes barricades de fortune, c’est un vrai chaos. Je me sens traqué, aux abois. M’emmurer, il faut que je m’emmure, que je m’enfonce dans l’obscurité et le silence à jamais. Je veux dresser une muraille infranchissable entre moi et ce monde que je rejette. Je brise une penderie pour recueillir du bois à disposer en travers des portes. Je réduirai mon espace vital encore et encore, je ne veux rien de plus vaste qu’un cercueil qui me laissera ivre de moi-même. Ma peau qui s’effrite, mes ongles, le fracas d’usine de mon système intestinal à l’ouvrage, mes articulations malmenées. Et ma respiration qui emplit tout, chuintante, envahissante. Le battement lourd et lent du cœur qui se répercute contre les parois trop resserrées. Rien d’autre n’existera que moi. Mon sang et ma chaleur.
Je commence à griffer laborieusement le mur du fond en gémissant, persécuté par le poids écrasant de la planète qui m’entoure. Du matériau pour m’emmurer, il me faut du mortier, des gravats que je disposerai cérémonieusement autour de mon corps. Remplir le volume restant de la pièce, qui me suffoque, m’engoncer dans un carcan de béton et de meubles brisés.
***
Jour 6 - 8 heures
Toutes mes fonctions mises en veille, tous mes circuits coupés en série. Déclin systémique d’un organisme privé de ressources, qui s’éteint progressivement. Ma grande carcasse repliée sur elle-même, mes mains osseuses sur mon ventre. La vie foisonnante que je renfermais il y a quelques jours à peine est anéantie. Tous mes muscles tendus, verrouillés. Je ne suis plus qu’une statue creuse dans laquelle palpitent de maigres organes atrophiés, desséchés. Une coquille vide, pétrifiée dans l’attente d’on ne sait quoi.
Jour 6 - 13 heures
Nouvelle plongée dans les tréfonds de mon abdomen. Je ressens désormais des parties de mon intérieur que je ne me connaissais pas. Des recoins, des détours obscurs au creux de mon ventre. La douleur et les signes sensibles du manque m'offrent comme une cartographie blanche et pulsatile de mon système digestif. Je sens, je sais où finit la poche stomacale, où commence le boyau. Je sens le diamètre des tubes. Leur parcours. Je les sens, chacun, distinctement les uns des autres. Au cœur d’une obscurité sans défaut, des masses organiques palpitent, et suintent d’une chaleur animale. Les intestins se nouent paresseusement, et remuent sans bruit. Le foie, comprimé sous mon diaphragme, reste éteint comme une usine à l’abandon. L’estomac, poche aplatie, vidée, est comme recroquevillé au creux d’une fosse organique. La vessie est vide, amollie. Je me sens empli d’une micro-cité désaffectée, qui se dégrade peu à peu. Je tente d’oublier ; je serre les dents à m’en éclater l’émail.
Jour 6 - 21 heures
J’aurai bien peu écrit aujourd’hui, mais je n’ai rien de particulier à signaler. J’ai pénétré dans un territoire obscur dont je ne reviendrai pas. Mes murs se dressent autour de moi, j’ai l’impression de les voir grouiller de mouvements intestinaux, j’essaie de les ignorer. Ma faiblesse s’accroît, mes fantasmes débordent dans la réalité.
***
Jour 7 - 8 heures
Le réveil sonne, mes yeux sont encore ouverts.
Je n’ai pas dormi. Je n’en ai pas eu l’envie, ni le besoin. Bloqué des heures durant dans le noir, le regard fixe. Toutes ces choses autour de moi commencent à ne plus exister, il n’y a plus que moi seul, perdu au fond d’un grand vide. Quelque chose étouffe les sons autour de moi, comme une chape de béton impalpable. Assis dans le lit, yeux grand ouverts, je perds la notion du temps. En même temps que les sons qui meurent étouffés, je sens les minutes s’étirer à l’infini. Je scrute l’affichage de mon radio-réveil, qui continue de sonner, soulagé pour chaque minute qui passe. Mon cri s’est mué en gémissement, sans que je m’en aperçoive.
Jour 7 - 11 heures
Je coupe le disjoncteur avant de succomber à la tentation de jeter un appareil électrique branché dans l’eau. J’ai arraché les douilles de toutes les ampoules à pleines mains. A travers la surface, j’observe les reptations incontrôlées de mes bras, je vois mes mains glisser sur mon ventre creusé, mes ongles trop longs griffer la peau comme pour pénétrer dans mon vide interne. Je suis pris de spasmes, je tousse, je manque une nouvelle fois glisser dans l’ombre. Des flashs brutaux éclairent le carrelage mural de visions organiques. Je les vois suinter de liquides bruns, se creuser d’empreintes d’organes au travail. Je me traîne hors de l’eau, arrache deux nouveaux comprimés de leur emballage blister et les pousse dans ma gorge endolorie. Mon système digestif asséché encaisse mal l’afflux d’eau dont j’accompagne les anti-inflammatoires et je vomis douloureusement, de longues minutes, dans le lavabo. Je m’effondre contre le mur. Maladie, dégénérescence, agonie. Agonie.
Jour 7 - 18 heures
La chaleur ne tombe pas. Je recommence à avoir faim. Saloperie de flotte qui passe trop vite. Je retourne boire au robinet de la salle de bains. Je me relève, et putain, toujours ce connard en face. Avec sa face de cire et son regard de mort. Je sens tout à coup mille regards me fixer de derrière mon reflet. Je balance mon poing dans le miroir, je l’éclate. Les fragments durs, chacun d’eux souillés de mon sang, s’écrasent dans le lavabo, avec un vacarme sec. Je donne des coups de poing frénétiques contre la bonde pour réduire ces choses en miettes inoffensives. Ma main saigne abondamment, j’ai les jointures et les phalanges profondément lacérées. La douleur irradie toute ma main, c’est comme si je portais un soleil de souffrance blanche au bout du bras. Je fouille misérablement dans ma réserve de produits pharmaceutiques, je mélange les emballages blisters, les boîtes de plastique. J’avale laborieusement les anti-douleurs les plus puissants à ma disposition. Il faut que je désinfecte, je dois avoir un antiseptique quelque part.
Je regarde mes plaies. Le sang qui coule paresseusement le long des doigts suspendus au-dessus du lavabo. Rien de très grave, mais j’ai vraiment mal. Je porte ma main à ma bouche, mais je l’arrête à quelques centimètres des lèvres. C’est manger. Le sang, c’est manger. Je reste immobile quelques secondes. Puis je cède. Ma bouche ouverte en grand, je mords le dos de ma main saccagée, j’aspire de mon mieux ; mes dents rouvrent les blessures sans pitié, je suce les plaies comme un forcené, mordillant, gémissant, oublieux des sirènes de douleur animale qui me dévastent. Mon sang. Mon sang a le goût de l’eau salée. C’est chaud. Puis tout à coup, aussi vite que l’envie est arrivée, elle cesse. Je bande sommairement ma main avec une serviette de bain que je noue, en serrant fort ; et je retourne me coucher.
***
Jour 8 - 4 heures
Je n’aurais pas dû manger ce sang. Après l’incident mon estomac s’est remis à fonctionner, laborieusement, comme une machinerie antique remise en route après des siècles. Ca m’a fait mal, je me suis tordu, les mains crispées sur l’abdomen. Mais ce n’était qu’un spasme sans suite, j’ai pu retourner à mon abattement inconscient. Plus tard, j’ai plus intimement informé que la digestion commençait, j’ai senti mes intestins bouger, se tordre comme un nœud de serpents dans ma cavité péritonéale. J’ai été rassuré, et j’ai pensé avec fascination à l’obscurité viscérale, celle qu’on ne brise pas. Toutes ces choses qui n’avaient jamais vu le jour. J’aurais voulu retourner à l’état larvaire et plonger dans ces bras organiques, m’y lover comme un embryon stupide, me noyer dans la noirceur chaude des intestins à l’ouvrage. Je me suis endormi presque immédiatement.
Pourtant, moins de deux heures après, je me suis réveillé, affamé. La faim, cette boule de rage prédatrice dans mon ventre. J’ai hurlé famine. J’ai détaché la serviette et j’ai tenté de lécher et mordre à nouveau mes blessures, mais elles étaient définitivement fermées et je n’ai pu en tirer aucune substance autre que des fragments séchés, dégueulasses. J’ai insisté, insatiable, j’ai rongé et lapé ce que je pouvais, sans succès. J’ai digéré mon sang, à présent je me digère moi-même.
Des ulcères se forment ça et là dans le bas de la poche stomacale ; puis les lésions s’accroissent sensiblement et se rejoignent. Les enzymes ont pu décaper la barrière de l’estomac, les cristaux pharmaceutiques en excès ont fragilisé la membrane. Puis les enzymes ont continué leur travail de forage, et continuent encore à élargir les taches blanchâtres, et à les approfondir, jusqu’aux nerfs. Tout se dégrade peu à peu. J’ai faim. J’ai faim.
Jour 8 - 8 heures
Le réveil sonne, j’ouvre les yeux pour mieux pleurer.
Jour 8 - 13 heures
Je fais du ménage, depuis des heures, pour occuper ma rage, défouler mon besoin désormais vital de netteté et de vide. J’épuise mes dernières ressources.
Ce matin j’ai voulu me nourrir de mes pauvres derniers excréments, produits minables de mon auto-dévoration. Comme ça, sans arrière-pensée, juste comme ça. J'avais déféqué pour la dernière fois les restes de mon repas sanglant. L’instant d’après, au lieu de tirer la chasse, j’ai arrêté mon regard sur l’étron. C'était moi, ça aussi. Ces pauvres traces brun-rouge. Je me suis agenouillé devant la cuvette. Je comprenais totalement la portée de mon geste, j’étais lucide et sain. Ca n’avait rien d’un acte de contrition et je ne cherchais pas à me punir. Non, c’était juste ce que cette matière mal digérée, encore tiède, avait quelque chose de commun avec moi, quelque chose de fondamental ; c’était moi-même, de tout mon être.
Je suis resté plusieurs minutes ainsi, à genoux, à contempler ma merde. Les yeux fixes. J'ai honte à présent, en l'écrivant. Saisissant ces pauvres vestiges ternes à pleines mains, j’ai mangé, les entrailles soulevées de dégoût et l’âme rayonnante de bonheur, j’ai mangé jusqu’à ce qu’il ne reste rien.
Evidemment j’ai vomi, longuement et douloureusement, et depuis cet instant je suis pris d’une frénésie maniaque.
Jour 8 - 18 heures
J’insiste sur les plaques électriques de la gazinière, encore maculées de graisse de viande figée. La vision de cette huile animale près de mes doigts manque me faire vomir à nouveau, mais je poursuis ma tâche. Le grattoir de l’éponge écaille le revêtement mais je m’en fous, je ne veux plus voir ça.
Je veux qu'elle disparaisse, cette sale graisse incrustée comme une peinture parasitaire. Je veux qu'elle disparaisse ! Je veux être seul avec moi-même. Les murs se remettent à bouger dans la quasi obscurité, derrière moi, je les sens, aux limites de mon champ de vision, pendant que je m’active. Je n'ai allumé qu'un néon d'appoint. Ces bruits infimes du grand bâtiment qui m’entoure, comme ceux d'un ventre.
Je m’arrête, haletant, ma pauvre éponge en lambeaux à la main et je jette un regard nouveau autour de moi. Quelque chose guette. Je me retire à reculons dans la pénombre, hors du champ palpitant du néon. Les chiens des voisins se sont tus, pour la première fois depuis dix jours, cent jours, je ne sais plus. Le silence de cathédrale s’emplit peu à peu d’un grouillement souterrain, à peine perceptible. Autour de moi, les parois s’enflent de tissus vivants, par à-coups convulsifs. Je mords le dos de ma main, nerveusement.
Je sens des vibrations profondes et des voix à peine audibles, comme venues de puits obscurs. Je les sens au creux de mes entrailles plutôt que je ne les entends. Les ténèbres bougent, j'en suis sûr, elles bougent mais s'immobilisent dès que je m'arrête, dès que je tends l'oreille. C'est une menace sourde, larvaire, lorsque je regarde autour de moi, ou un assaut fracassant et diffus, lorsque je tente de bouger, de changer d'endroit, de reculer.
Soudain le néon éclate et je me trouve piégé dans les viscères suintants et chauds de l’immeuble, seul dans son obscurité intestinale, harcelé de ses grondements chaque seconde plus forts.
Je hurle de colère, et il hurle avec moi. Je veux fuir vers l'intérieur de la pièce, mais les murs me poursuivent, j'en heurte l'un ou l'autre, toujours, partout. Il n'y a plus de plan droit, plus d'angles, tout est mobile, flottant. Les voix meuglent une parole continue que je ne comprends pas. Dans l'obscurité, je vois nettement les zones écarlates, les ombres noires d'encre laissés par les membres de la chose lorsqu'ils veulent m'atteindre. C’est le monde entier qui se rue sur moi pour me dévorer, m’avaler, me digérer. Je suis le centre brûlant de toute cette activité organique démesurée. Je sens l'énergie noirâtre et mouvante, incroyablement rapide, de toutes ces masses inconnues. Elles m'ont déjà pénétré. Je suis le hurlement. Je suis la violence et la douleur.
Je m’enfonce dans les méandres grouillants du monstre, cherchant une issue, une solution. Harcelé, je tombe à genoux, les paumes tournées vers le haut, dans un feulement de fauve mis à mort. Je respire un grand coup. Quand je rouvre les yeux, mes deux mains sont emplies de gélules bleues et blanches, elles débordent. J’avale tout ce que je peux sans réfléchir.
***
Jour 9
Je n’en finis plus de mourir. J’imaginais le processus plus rapide. Je croyais pouvoir rester extérieur à mon agonie, la contempler avec recul, la caresser du doigt avant de m’y engouffrer. Les mourants ont l'air si calmes, à la télévision, à chaque famine. Si détachés. Moi, je souffre, de toute ma chair, et de tout mon esprit. Est-ce que je suis différent d'eux ? Est-ce qu’ils simulent, est-ce que ce sont des comédiens payés pour jouer leur mauvais rôle ? Est-ce que ça aussi, ça fait partie du grand théâtre de marionnettes qu’est devenu notre monde ?
On ne peut vivre en cycle fermé, quelle illusion stupide, quelle pulsion aberrante, on ne peut survivre en se nourrissant de soi-même. L’absolu n’existe pas, il n’y a pas de clé de voûte qui maintienne la cohérence de la grande structure universelle. Personne n’existe par soi-même.
J’ai été incapable d’assumer mon statut d’animal ouvert à tous vents, qui s’alimente de toutes les scories transpirées par la terre, qui rejette ses déchets partout autour de lui. Mon identité, c’est l’ensemble diffus de toutes ces ordures, de tous ces bouts de moi qu’on m’arrache, de toutes ces choses étrangères qui entrent en moi. La compacité de l’organisme est un leurre. Je suis un vent de cellules éparpillées.
***
Jour 10
Je pose mes mains à différents endroits de mon abdomen. A nouveau, je palpe, je tâte. Mes doigts osseux visitent toute ma géographie intime. Je tente de retrouver au travers de la peau les zones de douleur, j'essaie de me souvenir de ma cartographie interne, mais je ne reconnais plus rien. Ca me démange dans le ventre, ça me déchire l'estomac, saloperies d'ulcères. Je griffe ma peau flasque et terne ; mes ongles laissent des marques grises, perlées de sang noir. Je teste tous les endroits ; près de la rate, mais elle est trop dure, derrière les reins, mais je n'arrive pas à les contourner, par les côtes, mais la peau est trop tendue. Il faut que j’entre dans cette machine à merde détraquée. Je rejette ma tête en arrière et je feule comme un animal blessé. Et si je n’étais pas comme les autres ? Et si mon organisme ne suivait pas les schémas classiques de l’anatomie ? Personne n’est allé vérifier, je suis peut-être conformé comme un monstre.
Mes doigts se font nerveux, s’agitent, fébriles, le long des courbes concaves de mon abdomen, butent contre l’obstacle osseux de la symphyse pubienne, contre les côtes. Je frappe, j’essaie de provoquer des remous audibles, une activité rassurante, mais le silence des organes, terrifiant, est absolu. Je suis mort à l’intérieur. De rage, je saute de mon fauteuil et je me colle aux murs nus. Comme pris dans une nasse, j’arrache le papier peint à grands gestes frénétiques, j’arrache les rideaux, je brise les fenêtres.
Je crie sans m'arrêter pour soulever un écho, mais je n'entends rien. Le sifflement dans ma tête est trop fort. Je veux me libérer de cette chape de silence aigu, je veux sortir de là, sortir de ce corps à demi-momifié ! Pourquoi lui mort, et moi vivant ? Je cours dans toutes les pièces au hasard, je change de direction seulement lorsque je m'écrase contre un obstacle. Je défonce les portes, et je sens ma peau céder sous les assauts. Je me précipite à la cuisine, et je détruis les placards, de rage. Tout leur contenu de vaisselles et de couverts s'effondre en vrac au sol. J’arrache les portes, j’envoie le four micro-ondes et la cafetière contre les murs. Impurs ! Toutes ces choses souillées d’une vie insupportable, qui me nargue, ces objets qui m’évoquent un passé dont je ne veux plus rien savoir. Je frappe le mur gris de toutes mes forces, mes mains éclatent peu à peu. Brusquement mon poignet droit se fracasse sous l’impact ; un fragment d’os effilé saille et déchire la peau, sur le coté de la main. Celle-ci s’est pliée selon un angle imprévu. Fracture ouverte et multiple. Irréparable. Je tombe à genoux, terrassé. Je suis vivant. Je suis vivant ! Je me sens vivre. Je prends ma tête à deux mains, mais la douleur me rappelle à l’ordre. Mes mains. A nouveau la chair déchirée de mes mains, et la structure brisée de mon poignet. Faim. Je me dévore les phalanges, débranchant gloutonnement les veines superficielles, déchirant la peau de mes dents dures. J’arrache mes ongles, je racle aussi les os fracturés. Insupportable. Une terreur absolue emplit ma conscience et je me saigne, et je me mords, et je jouis. Le sang est la vie. Le sang est la vie ! Une douleur monstrueuse m’empêche de me calmer. Les murs grouillent d’une vie sans nom, les contours d’un système intestinal titanesque s’y dessinent à nouveau.
Je me sens faiblir, je sens la force vitale se déplacer en moi. Le sang fuit mon avant-bras déchiqueté, et gagne mon estomac, qui enfle et rugit d'une activité inhumaine. Je me sens être où je devais être ! Je suis au cœur, je suis au creux, mon ventre est mon royaume. Que tout le reste crève ! Je fais éclater mes doigts un à un entre mes mâchoires. Je les serre jusqu'à les faire craquer, jusqu'à casser les phalanges une à une, et je les arrache, comme un cou de poulet maladif. Je mange la chair, je recrache les os. Mais je me lasse vite : j'avale les os aussi. La douleur n'est plus une douleur, c'est une vibration continue, de plus en plus grave, de plus en plus interne. Les sons réels s'éloignent, je me sens déséquilibré. J'accélère le mouvement. Je mords les métacarpes à pleines dents, et je beugle de douleur : je n’arrive pas à les arracher. Je relâche, et je jette mon bras contre la vitre. Encore. Encore. Le verre coupe et détruit peu à peu les chairs, qui pendent et saignent. Je m'acharne, je frappe encore contre le mur, dix fois, vingt fois, puis droit dans les éclats de l'encadrement de la fenêtre. J'arrive enfin à séparer les os. Je mords à nouveau.
L’incendie purificateur d’une souffrance sans bornes. Mes poignets s’ouvrent devant mes dents. C’est ma propre chair qui passe en moi. Une fureur incontrôlable m'envahit, de plus en plus, à chaque gorgée de mon sang chaud, à chaque lambeau de chair arraché. Je détruis le bel agencement des muscles sur l'os. Je saisis le milieu du muscle, dans un claquement de mâchoires, je serre, et je tire. Les petites fibres rendent un bruit d'écrasement, les plus grosses résistent et me font comme une liane de caoutchouc dans la bouche. Pas de goût, pas de goût ! J'arrache, et je remâche, pour la première fois depuis dix jours, depuis cent jours. Je me sens passer en moi. Je suis le cercle parfait, de l'aliment au tube digestif, le serpent qui se mord la queue. Je suis le Tout ! Des stridences de douleur me parcourent de bout en bout, je crie sans m'arrêter, mais je continue. Toutes ces structures admirablement disposées, organisées ! Les tendons qui relient les fibres musculaires aux articulations, impeccablement conformées, les veines et les faisceaux nerveux qui serpentent sous la peau, à l’interface entre le systémique et le local. Un ensemble si parfait, si précis. Je ravage tout, je détruis tout. Mes dents seront l’arme ultime du chaos contre l’ordre. Je suis mon propre prédateur. Je suis la chaîne alimentaire repliée sur elle-même. Je suis le commencement et la fin. Je veux pouvoir dresser deux moignons nets et polis devant ma face éclairée d’une rayonnante sainteté, je ne veux plus rien voir au-delà de mes poignets.
Un bourdonnement continu emplit ma tête, à présent. L’obscurité insupportable, en moi. Il faut que je sache. Il faut que je sache. Je me sens partir, je tombe.
Dans mon rêve d’agonie, je suis blanc et nu, plongé dans un océan de lumière douce. Tout mon environnement rayonne de paix et de chaleur. Je ne vois rien d’autre qu’une blancheur apaisante. Je saisis un couteau de cuisine de ma main gauche, et l’enfonce doucement au centre de mon abdomen. Je pousse jusqu’à la garde sans rencontrer de résistance. Pas la moindre goutte de sang. Lentement, j’oriente la lame vers le haut et je la laisse courir du nombril au sternum.
Les os broyés, martyrisés, cassés à angle droit, de ma charpie de poignet.
Non. Harmonie et plaisir. La peau se déchire comme un tissu, avec un son de soie découpée, les muscles abdominaux suivent sans que j’aie à forcer. Les intestins sortent de la plaie, comme doués d’une volonté propre.
Nœud de vipères grouillantes d’une furie sans nom.
Je respire et les visions de cauchemar passent. A l’instant où l’estomac franchit la frontière, j'entends un bruit étrange, presque un mot, liquide et chaud ; presque comme une parole prononcée par une bouche pâteuse.
L’odeur plate du sang et de la merde, l’odeur de saloperie puante, de charogne, qui inonde le monde.
Une nouvelle fois je chasse les pensées obscures. Mon système digestif qui s’échappe. C’est comme la fin d'un emprisonnement. Je ressens enfin, par contraste, toute la tension qui pouvait occuper mon ventre. Toutes ces choses comprimées dans l’obscurité de la cavité abdominale. Je me mets à l’écoute de mon organisme, j’écoute ce qu’il a à me dire.
J’entends la monstrueuse complainte de l’extinction, et je jouis.
Je règne en un domaine de viscères. La douleur n’est rien, rien d’autre qu’un artefact. Mon symbiote, mon autre moi, mon reflet. Mes organes me parasitent, ils me sont extérieurs. Je ne suis pas cet assemblage ridicule de chair et d’os, je ne suis pas ce système nerveux, ce sang qui serpente le long de mes membres. Je ne suis pas ce squelette mal foutu, corruptible à l’infini, et faible. Je ne suis pas ce réseau d’égouts imbécile des reins à l’urètre, ce pauvre système digestif de l’œsophage à l’anus. Je ne suis pas la chair faible, je ne suis pas la maladie, le dysfonctionnement, la douleur et la mort. Je suis bien plus que cela, j’existe au-delà cette pauvre matière putrescible. Mais je me décompose depuis ma naissance. Je ne veux plus de cette souillure de vie ; qu’elle m’abandonne comme je l’abandonne. Effondré en travers du carrelage dur de la cuisine, je me sers de mes moignons pour accéder à la réserve de produits ménagers, sous l’évier. Je pousse les bouteilles de détergent, dont certaines éclatent au sol ; je débouche les autres avec les dents ; je déchire les capsules de lessive ; je mords l’emballage des berlingots de javel. Et j’avale tout, goulûment, avec un plaisir sans nom. Je rejoins l’obscurité viscérale. Je m’enivre du silence des organes.
LA ZONE -
![[illustration]](/data/img/images/leper_clown(self-mastication).jpg) Je repousse mon verre sur la table, loin du bord, en sécurité. La dernière gorgée de Sauvignon blanc engourdit encore délicieusement ma glotte. J’achève ma tranche de pain grillé, chaude et croustillante, avec le Saint-Nectaire qui s’y abandonne, et fond légèrement. Je repose mon dos contre la chaise, en savourant les derniers élans de plaisir qui parcourent mes papilles gustatives. Je me laisse aller quelques minutes à la contemplation, je détaille les reliefs de mon dîner : les ossements dressés du carré d’agneau aux morilles, encore garnis de quelques lambeaux de chair froide ; la sauce hollandaise des quenelles, qui fige lentement au fond de l’assiette, et dessine en creux la forme des aliments ; la couche jaunâtre d’huile d’olive qui couvre les parois du saladier vide.
Je repousse mon verre sur la table, loin du bord, en sécurité. La dernière gorgée de Sauvignon blanc engourdit encore délicieusement ma glotte. J’achève ma tranche de pain grillé, chaude et croustillante, avec le Saint-Nectaire qui s’y abandonne, et fond légèrement. Je repose mon dos contre la chaise, en savourant les derniers élans de plaisir qui parcourent mes papilles gustatives. Je me laisse aller quelques minutes à la contemplation, je détaille les reliefs de mon dîner : les ossements dressés du carré d’agneau aux morilles, encore garnis de quelques lambeaux de chair froide ; la sauce hollandaise des quenelles, qui fige lentement au fond de l’assiette, et dessine en creux la forme des aliments ; la couche jaunâtre d’huile d’olive qui couvre les parois du saladier vide. Je fais l’effort de me lever, et je passe à la cuisine. Je lance un double expresso, que je fais couler lentement dans ma tasse favorite. Avec mon café fumant, je retourne m’asseoir devant le repas achevé. A petites gorgées, je sirote le café brûlant, et je m’allume une cigarette, la dernière du paquet. Je regarde le soleil s’enfoncer derrière la ligne d’immeubles sombres ; puis je ferme les volets.
= ajouter un commentaire =
Les commentaires sont réservés aux utilisateurs connectés.

![[nihil.fr]](/assets/img/nihilique/btn-rouage.jpg)
![[imprimer]](/images/print.png)






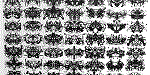




= commentaires =
Un travail impressionnant.
J'aime particulièrement la façon dont la folie monte en puissance jusqu'au paroxysme final.
Je reconnais les murs organiques et suintants, vivants, chers à Nihil. Mais pour être honnête, le texte aurait pu s'en passer : ok c'est une bonne image/métaphore, mais elle a été surentendue, du moins c'est l'effet que cela me fait. ca colle a l'histoire, pas de problème, mais c'est loin d'être la première fois que je lis un texte ou des murs devenus vivants se jettent sur le narrateur pour le devorer/digérer...Je dis Nihil parce que c'est un thème récurrent chez lui, mais si l'idée est de Glaüx, même combat !
D'un point de vue réalisme, je ne suis pas certain qu'après 10 jours de jeûne le narrateur aie la force de courir, défoncer les portes, démolir les placards. Mais bon, on peut supposer qu'il le fait quand même, étant donné que ça accompagne bien l'explosion finale de folie furieuse.
Par contre j'aime bcp l'idée de chercher a se manger soi-même, de faire un circuit fermé, et la façon dont ça a été traité est excellente (d'abord les excrements puis sa propre chair).
Au final, ça reste un très bon texte, à la progression bien dosée et au final spectaculaire...
bravo aux auteurs.
Pour les murs qui se jettent sur le narrateur, j'avais pas fait le rapprochement avec la scène de rêve du texte dont je suis le héros (et oui, je sais que y en a d'autres ailleurs). Désolé. Mais j'ai précisé dans le résumé que ce texte n'avait rien d'original. Basiquement, si t'as lu Arch-Nemesis, Fiction organqiue, le texte dont je suis le héros, On raconte... alors t'as lu ce texte. Mais perso j'écris régulièrement depuis bien longtemps, je ne me crois plus capable d'écrire des choses originales. J'ai un certain nombre de thèmes de prédilection que je traite encore et encore jusqu'à la nausée, jusqu'à ce que j'ai tellement écrit sur ça, sous tellement d'angles différents que j'en ai moi-même ras le bol. Je suis pas très imaginatif mine de rien, j'ai un petit nombre d'idées et de recettes originales en elle-même que je réutilise toujours, en les combinant différemment. Tu prends de l'hôpital, de l'hypocondrie, de la boyasse, des chiens, de la religion, des jouets qui parlent, des chiens et t'as un résumé exhaustif de ce que je peux faire. Je me console en me disant qu'un lecteur lambda qui n'a rien lu de moi peut aimer.
Pour le réalisme du texte, c'est un problème délicat. On a pas fait de recherches sur le sujet, on a fait un peu à vue de nez, c'est pas évident. Je crois pas non plus qu'un mec peut se bouffer les deux mains sans tomber en syncope avant d'arriver au bout.
Commentaire édité par nihil.
çà aurait pu être le journal intime de Josh de Survivance aussi.Mais on est un peu là aussi, pour nous entredévorer les uns les autres. J' y prends du plaisir aussi. La Zone c'es aussi un grosse pelotte de rejection qu'on fait tourner.
Je viens de finir de lire le jour 1. Mais je vais quand même aller manger. C'est pratique, ça peut se lire en feuilleton.
c'est ça, va bouffer, connard d'obèse.
Jésus est mort pour toi, tu sais, ça ?
J'aimerais bien que tout le monde puisse en dire autant, ça me ferait plus d'air pour respirer.
Le deuxième jour est très bien. On ne peut que partager la soif de silence du narrateur. C'est une cellule de moine, qu'il lui faudrait. A une époque plus civilisée que la nôtre, de tels personnages auraient pu trouver leur place.
APres l'emission : un livre, un jour
voici le remake Smerdiakovien : un commentaire, un jour
non c'était juste pour avoir mon nom partout, ça me fait gerber de voir les vôtres sur mon écran
Je trouve ça dommage que vous n'aillez pas poussés l'idée de la faim justement. Ce côté là du texte avait le mérite d'être original et bien traité. Autant dire que j'ai préféré le début que la fin.
Du coup la fin m'est passée au-dessus, non pas parce que c'est du deja-vu, mais parce que je trouve que ça enterre le sujet initial par des considérations et des actes qui ne font pas très "réalistes" dans pareil situation.
Bon là on a l'impression que j'ai pas aimé alors que c'est pas du tout le cas. C'est très bien écrit et ça tape comme il faut. Juste un peu frustrée par un début vraiment prometteur.
0n était conscients de la longueur du texte à prévoir, si on avait voulu être réalistes, et traiter à fond, méthodiquement et posément, l'escalade de la faim. C'est salement résistant, une machine à merde, et ça met du temps à mourir.
Du coup, on a préféré presser un peu, et arriver vite (en cassant le "réalisme") aux crises.
Qui étaient salement jouissives à imaginer et à écrire à deux, d'ailleurs. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a insisté dessus.
C'est pas les "crises" que je soulignais, juste le fait d'avoir trop insisté sur le délire des organes et peut être pas assez sur d'autres symptomes que pouvaient amener cette situation.
Je participe parceque j'ai la même alimentation.
Difficile de décoller les yeux une seconde de cette espèce de saga introspective hallucinée : le corps est retourné de fond en comble pour en arriver à la matière pure. Nous ne serions donc que merde et chair immonde. Miam. Superbement écrit.
Avec une phrase finale (nihilienne) tout à fait agréable, je tiens à le signaler eu égard à la période de disette qui nous accable.
Mais enfin, Glaüx, y a de super beaux textes en ce moment. T'as lu Paranoïa Agents? C'est l'équivalent littéraire d'un bon vieux Ed Wood...
commentaire édité par Mill le 2007-3-19 12:36:52
Oh non faut pas se moquer des gogols, même des textes gogols, c'est pas bien.
J'ai beaucoup de respect pour Ed Wood. Il a fait exactement ce qu'il avait envie de faire toute sa vie durant. C'est pas donné à tout le monde.
Fais gaffe, avec un raisonnement pareil, tu pourrais en venir à aimer Bernard Werber juste parce qu'il fait de la merde et qu'il aime ça.
Werber n'écrit même pas ce qu'il signe. Il présente un synopsis "développé" à son éditeur et c'est un nègre qui rédige. Ma source : Ptiluc, qui le connait personnellement. Donc, non. Na. Hihihi. A + masta Glaüx.
A lire absolument.
alors là, BRAVO !
le plongeon volontaire dans la folie, la prise de conscience à mi-chemin qu'on joue avec quelque chose de plus grand que soi, l'échec de la négation du corps, l'absurdité qui s'instaure avec la solitude, le tout dans une ambiance complétement hallucinée.... tout ce que j'aime !
c'est vrai que c'est un peu dommage de pas s'être attardé un peu plus sur les effets de la faim, ça donne un côté très détaché à l'ensemble, un peu trop à mon goût. mais bon, du détail tout ça !
ça m'a fait bien penser à "la faim" de knut hamsun, que je conseille à tous ceux qui ont aimé ce texte
Mais AU FOUR LES ENTHOUSIASTES §
Laborieux dans la lecture (une course d'endurance), c'est le genre de textes que l'on lit avec un fond sonore; exocet me paraissait tout indiqué, ça a donné une certaine saveur.
Deux trois écarts de registre tout de même, mais rien de bien affolant.
Le final m'a paru trop inéluctable; difficile avec un contexte pareil de faire dans le vraiment original.
J'aime bien, mais je ne le relirai pas.